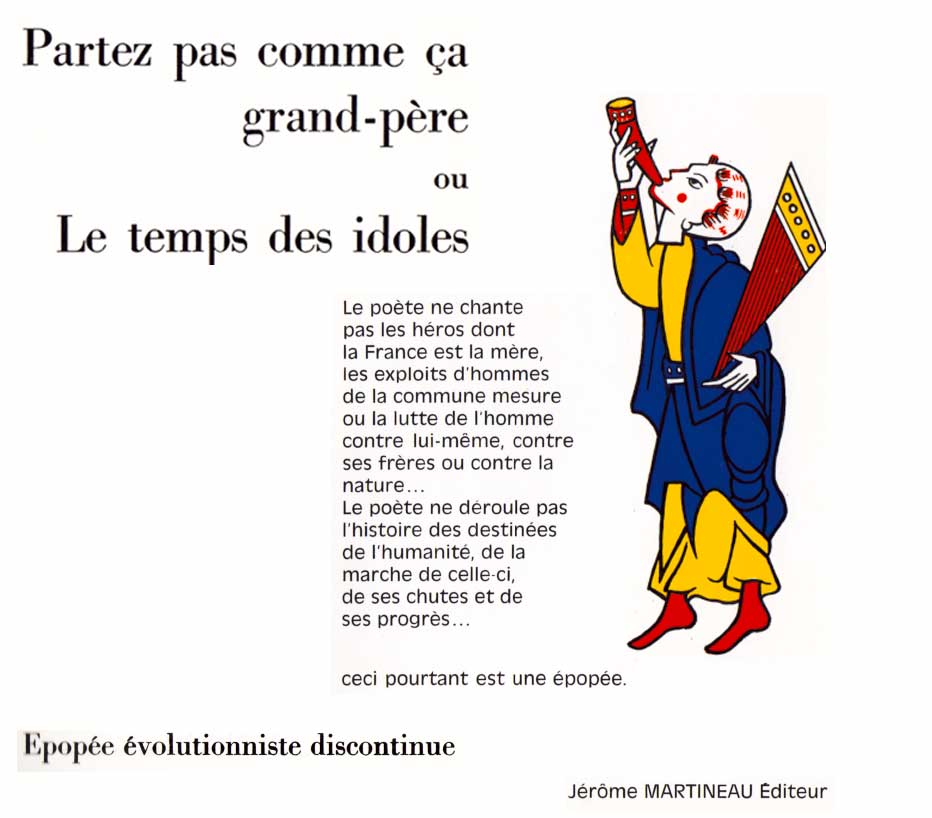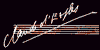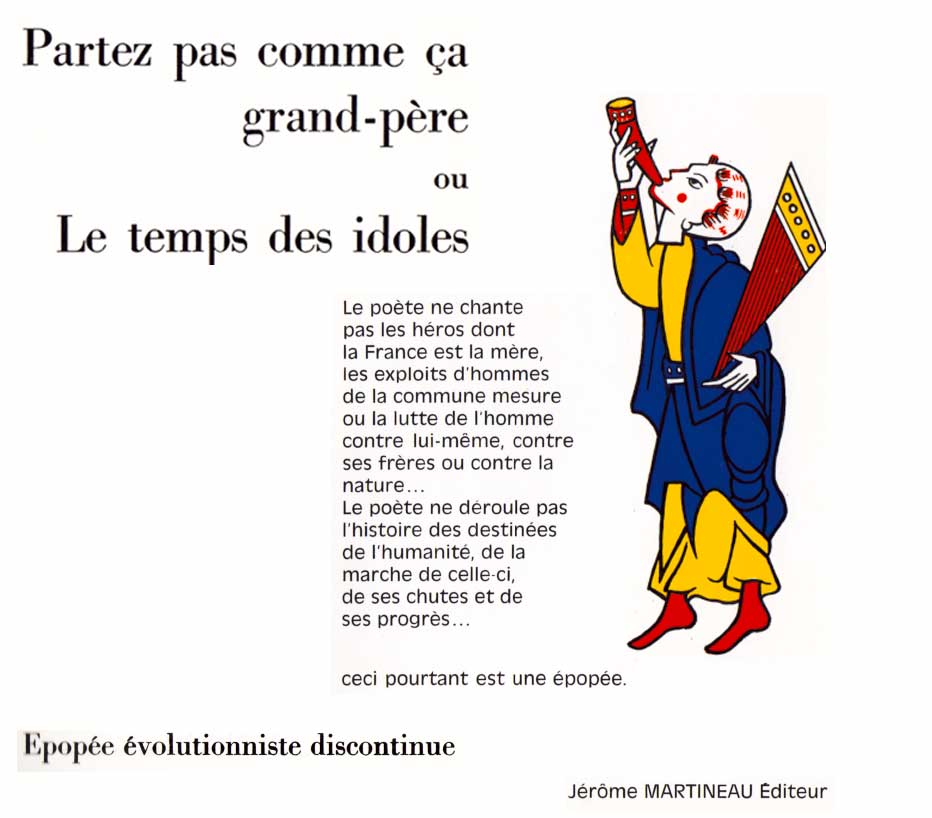 Quarante hommes. A peu près contenu wagon guerrier. Quarante hommes. Reste compagnie après désastreuse journée Charleroi. Quarante sur deux cent cinquante mobilisations. Encore ces quarante avec autres rescapés bagarre foncer jambes au cou vallons belges rempart Meuse. En Belgique, régiment a glissé dans traquenard champs, bois, ravins, enclos, ruisselets, brouillards. Puis soleil tâtonnant.
Alors fond horizon ouaté, feu artifice sanglant éclate. Obus, shrapnells se déversent vrac sur pantalons rouges. Fusiliers, mitrailleurs allemands, embusqués avoines, multiplient coquelicots pointe bouches à feu. Saint-Cyriens gants blancs, officiers encore vifs savent pas conjurer destin. Trois heures massacre. Anodine riposte lignards surpris, privés soutien d’introuvable artillerie. Trois heures - siècle. L’inévitable " barrons-nous, sommes tournés ! " Recul pagaïe. Rivière étroite. Pas pont. Eau méchante recouvrant chaque clapotis paquets hommes sauvés balles. Fuite par coteaux brûlés soleil d’août, par sentes farcies éclatements. Village, autre village, villages. Voitures régimentaires, maisons flammes. Cohortes blessés soutenant, tirant plus éclopés. Gendarmes affolés tremblent. Colonel à genoux balaye route franges drapeau exhortant vainement hommes mourir pour Jeanne d’Arc. Enfin décramponnage avant-gardes allemandes. Trente heures encore repli heurté vers bastion Meuse. Derrière survivants, ponts cabrent et meurent.
Ainsi débute marche Berlin.
Les pieds glaisés par une bouillasse infâme, au cœur d’un bois dominant la Meuse, trente hommes à l’appel au fil des heures. Dix brebis égarées retrouvent le troupeau. Pertes du régiment : dix-sept cents hommes, vingt-sept officiers.
- Vive la guerre, avait créé Vanderbique le deux août. Il est parmi les dix-sept cents. Douze cents types du dépôt débarquent en renfort : fusils équipés de bretelles pour bidons, ceinturons de ficelle. Il ne manque pas un bouton de guêtre. Jetés nuitamment aux avancées du front, les nouveaux venus heurtent des bras et des jambes, croient qu’ils piétinent des morts, ne savent où s’étendre, restent piqués comme des hérons. Un d’eux, vraisemblablement ému, vide son estomac agité sur la face d’un aspirant, sans doute rêvassant aux charges épiques promises à Saint-Maixent. A l’orée d’un bois, sur de lointains versants, des feux.
- Feux de bivouac, feux de bivouac ! ... affirme l’officier qui� nous arrive du dépôt. Il a fait son apprentissage à Madagascar. Pente douce. L’herbe mouillée descend vers la rive meusienne en s’enfonçant dans le brouillard. D’horizons divers monte vers nous le choc sourd des canonnades.
Un petit obus de montagne en provenance d’une vallée de l’arrière s’en va paisible et solitaire troubler le campement des gens d’en face. Plein jour. Fouillenbois, cul au sol, au milieu de faces crasseuses, maugrée :
- �a, c’était couru avec les officiers que j’avions ! De braves figures opinent. Papelard évoque son sac dont il s’est délesté en cours de fuite. Une demi-livre de chocolat perdue. Unique ressentiment contre tout.
- Des sections squelettiques tournent sous les futaies.
- Pas de boches�Vous n’avez pas vu de Boches ? ... On dit qu’ils ont passé la Meuse !... halète un officier sans képi.
- Sur nos 100 nouveaux bourrant les vides, 40 Alsaciens-Lorrains, la plupart ignorant le français.
Patrouille du soir avec l’un de ces Alsaciens � un bilingue. Cinq hommes se coulent en silence par sentiers et boqueteaux vers une cabane de passeur plantée sur la rive meusienne.
Des ombres mystérieuses bougent de l’autre côté. Les bottes de paille se déplacent seules dans la prairie sombre.
- Pour moué, y’a queuque chose de louche, susurre le Berrichon. Coups de sifflets étranges, sinistres, lueurs de pipes que mon compagnon croit être des signaux entre Pruscos.
- Etalé à trois pas de l’eau, l’Alsacien tend l’oreille aux jabotements d’en face. Coup de gueule plus fort que les autres.
- Quoi qu’i disent ? Quoi qu’i disent ? demande anxieusement le cabot à l’Alsacien qu’il tire par le pied.
- Ils disent que les cuisiniers sont des cochons. Soulagement. Agrippés à l’espace noir, des chants méthodiques circulent gravement.
- C’est leurs morts qu’ils enterrent, affirme David Hacker. Au retour, lente rampante, la patrouille tressaille au plus léger bruissement, se trompe de route, tombe sur des troueurs de tranchées qui détalent, croyant à une surprise. Parlote, reconnaissance au milieu de l’opacité du vallon� Jour.
Vingt hommes partent vers l’arrière � ravitaillement au village � le doigt sur la gâchette.
- Le Boche aurait pu se glisser jusqu’ici� énonce le sergent-major Durillon qui commande la corvée. Nous évitons un bois haché par les obus, enfilons un maigre sentier où nous tombons nez à nez sur une équipe du génie � pelles, pioches � qui, déjà oublieuse du 22 août, s’étonne de nos précautions. Plus loin, troussement de branches. Equivoque.
- Là-bas, ça remue. Baïonnette au canon ! En avant ! hurle le sergent-major. Au pas de course, revolver, sabre en mains, poitrine aux balles, yeux mi-clos. Durillon se sent déjà mort. De paisibles artilleurs affairés à mijoter leur pitance nous examinent bizarrement. La marche reprend, affermie. Des obus�des obus�Tchaaft ! Tchaaft ! Baaoum ! Booum ! Boum ! Les ventres s’effacent, les corps se tassent. Soudain un aéroplane, un français. Tout de même. Le premier qu’on voit depuis le début, pas trop tôt ! Nous en sommes tout émus. Papelard en urine de satisfaction.
- Mais que fichent Védrines et Garros ? On n’entendait que leur gueule avant la guerre ! Ricane le sergent-major, lequel ne quitte ni pistolet, ni sabre. Village ceinturé de trous effrayants ouverts par les obus, chus il y a à peine une paire d’heures sur une batterie imprudente, décampée depuis. Voitures, carrioles, autos, prolonges, bicyclettes, pêle-mêle, équipements, essieux rompus, caissons criblés obstruent les fossés. C’est le convoi du corps d’armée. Artilleurs sans canons, cavaliers sans cheval, traînant leur lance, éléphantesquement bottés, ont l’aspect de Donquichottes de carnaval. Au large des chemins, autour des taillis, foisonne une soldatesque en quête d’unités mutilées.
- Oh, là ! Foutez-moi le camp, malheureux ! ... Ici explosions, obus à la mélinite� braille un commandant nous pointant de sa cravache.
- Commandant ! Nous sommes la corvée de�du�
- Foutez-moi le camp, Nom de Dieu ! Où je porte le motif ! ... Repliés à l’abri d’un tertre, feuilletons le Bulletin des Armées (première édition). Victoire, victoire ! Partout ! Liège ! Russie ! Serbie !
- Bon sang, y a que nous que je reculons, s’apitoie Fouillenbois. Toujours pas d’ordres pour nos vivres. Ecrabouillement méthodique d’un bois par l’artillerie ennemie prodigue. Tant pis, dormons� Le plus géant des sommeils. Quatre effroyables explosions ! Nuage de fumée qui nous enveloppe. Bondissement, sabre au clair, du sergent-major. Galop général de l’autre côté du tertre, chute sur une batterie de 120 qui vient d’aboyer à deux mètres au-dessus de nos têtes. Rire des artilleurs à nos dépens� Le ravitaillement aurait, paraît-il été laissé sur la route en corniche dominant la Meuse. Nous remontons vers les avant-postes.
- Quel est le salaud qu’a fait ça.
- C’est le civil qui ravitaille avec sa bagnole.
- Tous des traîtres dans ce pays, clament des voix. Une saucisse ennemie dorée et lointaine rissole dans un ciel serein. Une fraîche source où viennent mourir quelques balles perdues nous redonne l’usage de l’attache de la langue. A la nuit, boules de pain piquées à la pointe de la baïonnette, demi-tour précipité, ferraillement des gamelles qui dansent à nos mouvements désordonnés.
- Tas de froussards - s’époumone Durillon, déjà encastré au sol. Traversée d’une forêt sans nom. Nos godillots heurtent des corps roupillant.
- Quel régiment ? Où sommes-nous ? Jurons et ronflements répondent. Chacun dit son mot pour faire passer le temps. Torlequin en arrive vite aux exploits de son grand-père à Gravelotte. Cycliste égaré nous annonce l’entrée des Russes à Berlin. Les attendrons ici, c’est certain. Cataracte de shrapnells qui massacre la futaie, obstrue nos gorges. Fuite à quatre pattes vers les abris branchus, installés par le génie.
- Qu’est-ce qu’on fout ici ? S’inquiète Durillon. Un hussard pressé, du haut de sa cavale, nous jette :
- En arrière, Nom de Dieu, les boches ont pris le pont.
- Mais, y’a une section en tranchée qu’est devant nous !
- Vous occupez pas de ça. En arrière ! Claquements secs sur les arbres impassibles. Une mitrailleuse hoquète à vif régime. Le galop du hussard s’éteint dans les fourrés ombreux. En ligne déployée, la section reprend le chemin de la veille, contourne les halliers, récolte des tirailleurs solitaires, tire vers la droite où d’invisibles casques à pointe progressent sans doute à la cadence de notre rétrogradation. Le village ! Cohue agitée. Mélange d’uniformes. Des officiers menacent. Regroupés au petit bonheur, les unités se pressent sur le chemin traversant la plaine. Au zénith, le soleil cuit nos membres sans ressort affalés sur une herbe froissée comme les pelouses de Boulogne après la revue de Longchamp. Quelle équipe ! Où sont nos ridicules guêtrons de cuir ? Perdus au long des kilomètres, de même que la plupart des sacs. Seuls les nouveaux copains, frais arrivés, ont encore quelque respect pour la vêture militaire. Marche en chevaux de bois. Enfin la compagnie. Vite, deux sections aux tranchées, l’Alboche franchit la rivière dans le bas-fond fond. Ravines impossibles, dégringolade dans le brouillard � C’est ici : Maldonne. La tranchée est occupée par des inconnus. Allons voir plus loin. Attention. Pas de bruits. Serrez vos baïonnettes au corps ! Une fosse. Voilà. Un saut. Ils peuvent venir. On les attend.
Dissipation du brouillard. Notre tranchée baille rectiligne comme au champ de manœuvres. Le sergent Finette pointe ses jumelles. Tonnerre ! Notre tranchée est dans un ravin. Depuis minuit nous tournons le dos aux Allemands.
- Quel tas de cons qui commandent, glapit une voix souterraine. Des blessés dévalent dans la grisaille. Visages barbouillés de sang. Une volée d’obus français écrase pour la vingtième fois les travaux de construction de pont d’un adversaire obstiné. Une section inconnue nous remplace, saluée par des shrapnells. Mordus par les branches, nous regagnons la compagnie sur les hauteurs boisées. Personne. Sommes-nous perdus ? Attente. Les hommes rongent singe, biscuits réfractaires aux mâchoires. Quatre faces barbues se prennent à taper la manoche. Les mal résignés jurent, jugent, prophétisent.
- Le corps d’armée est mis à mal.
- Ce fumier de Barbichu i’nous a trahis.
- I’rigolait quand je battions en retrait’, l’aut’jour.
- L’a été vu, menottes aux mains, dans une auto de gendarmes�Trombe d’automobiles blindées. Des familles d’obus fouillent les bois à leur rencontre. Couchés sur l’échine, nous attendons les évènements. Un avion allemand vacille sur une aile, rejoint ses lignes vers une bagarre dont les échos arrivent jusqu’à nous. Apparaissent des blessés du régiment qui nous a remplacé cette nuit. Certains perdent le sang en abondance malgré les pansements enrubannés à la hâte.
- Ah ! Les gars qu’est- ce qu’on s’est fait mettre !
- Sont trop nombreux, hurle un autre. Tiens, les v’là ! Bousculade. Frisson de foule, Branle-bas de combat...
- Aux armes ! Aux armes jappe un vieux cavalier à bicorne panaché de blanc� Le général de brigade en personne ! Dressé sur ses étriers, il tournique son épée, s’oublie au grade de chef de section. Son état - major reste tapi à l’abri du chemin creux.
- En avant ! En avant les enfants En avant ! A la baïonnette : C’et pour la France ! Le Vieux paye d’exemple, lance sa monture à l’assaut du talus, menaçant les hommes qui s’agrippent, le cœur chaviré. Le cheval s’accroche, tombe sur le cul, vide son cavalier emplumé dans un éboulis de bras, jambes, de fusils d’où montent des cris de cochons saignés.
- En avant ! En avant ! Le général démonté, chapeau au bout du sabre, comme à Valmy, arrive avec nous au sommet de la pente où va se jouer l’impérissable exploit. Personne ! Une plaine triste et vide. Des flocons d’obus à l’horizon. Personne ! Derrière nous, sur la pente, la jument du général joue de la croupe mais son vieux maître n’en à cure.
- En avant ! Farfadet cyclopéen, il sautille dans les labours suivi de son indécis troupeau.
Le décor change. De gros calibres s’écrasent alentour. Panaches volcaniques. La terre tremble. Un fossé : couchez-vous! Pas de place, pas de place. Les derniers arrivés poussent de la boule pour se fourrer sous les ventres. A gauche, un bataillon surpris en formation compacte. Les hommes tournoient, s’écrasent.
Un bond de deux cents mètres nous porte à la lisière nord d’un bois. Les flocons jaunes, noirs flottent dans l’air, crevés par des bouts de ferraille qui giclent dans tous les sens. Pas un chat à l’horizon. Mais si. Les têtes se tournent. Une silhouette se détache, là-bas, quasi immobile. Un homme statufié, insensible à la pluie infernale. C’est le lieutenant-commandant de notre bataillon par intérim, le rude Calotard. Aplatis, pêle-mêle, le nez collé aux souches, fusils appuyés, nous nous croyons indélogeables. Les langues se mettent à remuer. Des tourbillons opaques roulent soudain autour de l’isolé.
- Il y est ! Il est tué ! ...
- A ton idée ? Soixante kilos de viande contre cent de ferraille, siffle un copain stupéfié par tant d’intrépidité. Une brise disloque l’écran fumeux. Calotard n’a pas bougé d’une semelle du godillot. Cris d’admiration.
- Ah, la vache ! A l’ouest, sur crête lumineuse, des pantalons rouges trottinent autour d’un petit bois pour illusionner l’adversaire sur notre chiffre de combattants. Deux heures durant, la même section de chevaux mécaniques se pointe, s’engouffre dans le chemin creux, contourne le boqueteau, réapparaît modifiant à chaque virée le port des pans de la capote. Le dernier de la ronde laisse scintiller sur son dos un immense plat de tripier décelant la supercherie. Les observateurs du ballon allemand oublient de signaler cette enfantine roublardise à la voracité de leurs canons. Une bosselure de terrain où se tapit une tranchée sous les broussailles. Amis ? Ennemis ? Un colonel d’artillerie à nos côtés depuis des heures, s’inquiète tout en mâchonnant nerveusement, brin après brin, une botte de foin voisine.
- Voyons, lieutenant, poussez par là quelque patrouille. Le lieutenant jette les hauts cris. � N’ai pas d’ordres � N’ai pas d’ordres, mon Colonel � le colonel choisi alors un nouveau brin, suçote en silence. Etonnement. Ce sont bien deux zouaves qui arrivent de la tranchée en clopinant.
L’un braille à tue-tête des chants difficiles à comprendre, l’autre nous assure qu’il ne sait rien, pas plus que d’où il vient. Allées et venues de galonnés d’état-major inquiets pour leurs montures. Progression de mitrailleurs, de leurs mulets porteurs qui parfois s’échappent, s’ébrouent, pétouillent, ruent pour mieux recenser leurs chargements jusqu’à ce qu’un éclatement surprenne leurs vieilles oreilles mal accoutumées à ce tintamarre. Un blessé fuit en soutenant sa mâchoire pendante. Cela devient malsain. Sous leur ventre, tels des chats surpris, les hommes qui ont perdu pelle et pioche, creusent le sol avec leur quart, leurs couteaux, rejetant la terre à pleine mains. Les balles miaulent dans les feuillages. Accalmie� Mirettes à l’affût. Mais oui, ce sont des Franz�se qui s’ébattent près de la tranchée mystérieuse. Va et vient d’hommes. Du bois tourniquet sort une civière à la rencontre d’un obus qui envoie au ciel les quatre infirmiers et leur blessé. Le colonel mâcheur de foin n’est plus à nos côtés !
Incohérent spectacle depuis des heures !
En sortant un peu le cou de nos carapaces, nous apercevons, là-bas, à trois ou quatre mille mètres des lignes ténues de tirailleurs qui montent, qui descendent, remontent comme à l’exercice. Qui sont ces gens-là ? L’Allemand s’offrirait-il cette fantaisie à la gueule de nos 75 ? La bagarre se déroule-t-elle ici ou là-bas ? Personne n’y comprend rien. Gradés et sans-grades ne savent que penser de cet inextricable puzzle, quand vingt combattants sortent soudain d’un hallier, mains aux poches, pipe au bec. La nuit approche d’ailleurs. Déjà des groupes voisins retournent en ordre dans le village, telles les compagnies de paix regagnant leur caserne avant le quartier libre et la soupe. Impression fugitive qui s’efface devant l’image des morts de ce jour sans gloire.
Au loin, de l’autre côté de la Meuse, l’artillerie française enfin éveillée mord à plein flocons gris dans la verdure. Si seulement on avait vu un Boche ! bougonne Durillon. Aux abords du patelin les groupes éclatent, emmanchent des ruelles au hasard chassant le cantonnement - rare - du fait qu’artilleurs, canassons épuisés, recrues d’arrière sont déjà là depuis belle lurette. Des deux côtés de la chaussée, tas de crottins, boyaux de vaches abattues, blessés à l’abandon, s’amoncellent. Des ribambelles de caissons, de carrioles, de canons se serrent dans des jardins piétinés sous le feuillage anémié des pommiers qui les abrite de l’œil d’avion.
Nous attendons stoïquement le retour des fourriers, de leur coin de grange choisi pour le repos de nos abattis. Le reste d’habitant, hébété, charge ses hardes sur l’ordre de décamper. L’invasion est à sa porte. La cinquième, en avant ! Happés par un porche, c’est la course au bon coin.
Le fonctionnaire caporal, Alsacien hier encore feldwebel chez ceux d’en face, fulmine contre l’obscurité, le ravitaillement en panne. En attendant, distribution de 120 cartouches par personne : les fusils mangeront à leur faim. Les équipements choient sur le sol. Des pieds douloureux s’extirpent des godasses, tout pâles à la lueur triste d’une maigre bougie. L’Alsacien se fâche : il n’admet pas ce déshabillage à un demi-kilomètre de l’ennemi. Nous restons donc boudinés dans notre attirail, fusil sous la main, ventre creux, cerveau farci d’émotions neuves, Dormir !
La canonnade triture plus intensivement la forêt proche cherchant de problématiques batteries. Paraît qu’on aurait agencé des canons en bois, pour tromper l’adversaire - de là cette débauche� Dormir! Par les rues boursouflées de cailloux déboulent des attelages multiformes. Carambolages, cris, jurons. Mille pattes ferrées cliquètent au sol. Le bruit augmente. Des mulets agonisent sur le pavé gluant de mouscaille et de sang. Hurlement d’hommes, de bêtes, frappées à mort. D’un canon en marche, les servants bondissent pour s’aplatir au sol. Dans la nuit une voix casernicole beugle.
- A cheval ! Nom de Dieu� A cheval ! Huit jours de prison. A cheval ! Mes apeurés traversent l’âcre fumée, sautent en selle. Le torrent continue sans s’inquiéter des touchés par la salve encore chaude�
- Debout ! Debout ! Tout le monde dehors !
- En avant !...
Une courte marche. L’aube naissante. Des maïs chevelus haut-perchés craquent, cognent nos genoux dans ce champ sacrifié. Le colonel, sur son coursier, longe mélancoliquement ses bataillons crasseux. Se raidissant, il commande des évolutions ordonnées à son troupeau ahuri � pour reprendre du poil de la bête. Alsaciens, réservistes, volontaires, inaptes à ces parades de garnison, virent à contre-sens. L’ex feldwebel, dressé à l’allemande, court, jappe, cognotte du poing à tort et à travers. Un capitaine crève d’un rire impossible à réprimer. Tiens, encore là ! Nous qui pensions l’avoir " oublié " en Belgique.
- Portez armes ? Qu’es aco ? Sans doute " Présentez armes " ! Indécision ! Les uns jettent leur fusil sur l’épaule droite. Les autres le tiennent à mi - corps. Deux patriarches du volontariat le présentent comme un cierge entre les mains d’une enfant de Marie. Les Alsaciens, naturellement, portent l’arme à gauche, à la prussienne, le colonel se fâche.
- Reposez, armes !
- Au temps, portez armes ! répète le vieux commandant. Indécision, affolement. Une haie de baïonnettes vacille à la recherche de la place réglementaire, ce qui conduit au paroxysme le dépit du Colon. Tant pis. Trois clairons vibrent de tout leur cuivre. En colonne et " en avant " vers l’arrière, ironie. Une cavalerie aux éléments dispersés protège notre retraite. Un vague brouillard qui traîne dans le secteur facilite notre dérobade. Faisons vite. Un monde mal intentionné fonce à nos chausses. Des voix grognent.
- Qu’est-ce qu’on fait ? Où on va ?
- A Verdun répondent les officiers.
Vous ferez le café au prochain village. L’espoir d’aller se mettre à l’abri derrière les murs de la forteresse calme nos appréhensions. Le bruit court que le corps d’armée a priorité vu qu’il a le plus souffert. Baucheux, le cabot- instituteur, se gausse de notre candeur. Il nous assure que nous reculons " sur tout le front ". Sur tout le front ? Est-ce qu’on se bat ailleurs qu’ici ? Evidemment, nous savons bien qu’en Russie, qu’en Alsace, voire dans le Balkans, ça guerroie. Mais en France ? " Y’a que nous qu’on se bat ", réplique Fouillenbois avec conviction. Baucheux n’insiste pas.
Des tourbillons de fumée annoncent un village où des cuisiniers doivent encore opérer. C’est notre tour. Sachets de café, sachets de sucre, boules de son apparaissent avec le matériel de campement. Déjà les flammes poussent, grimpent, s’étirent par-dessus les foyers improvisés. Malédiction. Notre chaufferie s’est fait repérer. Une volée d’obus de tous calibres châtie notre inconséquence. On repart. Une fatigue morne, aggravée de fringale, s’empare de nous. Si seulement il nous était loisible de poser nos fesses un instant pour tortiller le pain sauvé du naufrage. Rien à faire ! Le repos théorique au bout de cinquante minutes n’est plus que carotte de métal devant un alléché. Les épaules s’engourdissent sous la morsure des cuirs du sac que l’on catapulte à chaque minute avec un frisson de chair. Bon sang, qu’il est lourd ! Et ces saloperies de cartouches ! Alors l’instrument de torture va discrètement rejoindre ses frères qui jalonnent le fossé. Nous traversons la vaste campagne où rôdent quelques bestiaux l’air absent. Deux bourricots nous font escorte sans éveiller le moindre quolibet. Personne ne parle. Front tendu, mâchoires serrées, tout l’effort est dans les jarrets qui assurent la mécanique et indispensable foulée. Toujours plus vite !
- A midi nous livrerons bataille, promet le sergent Finette. Nous ferons brutalement volte-face. Il nous annonce aussi le jumelage des 5� et 7� compagnies. Les hommes proposent, les pertes disposent. Le lieutenant Bellejambe en prendra le commandement�
- Halte ! Demi-tour ! En tirailleurs ! Couchez-vous ! Nom d’une pipe, qu’on est bien dans les betteraves qui se moulent aux tripes. Face contre terre, un divin engourdissement nous saisit. Quelques ronflements montent aussitôt de la masse vautrée. Ma bouteille d’alcool de menthe, promue " bien commun ", mouille les lèvres de mes compagnons d’armes. Sous l’estivale fournaise, coincé à une bavure de terre, mon esprit vagabonde, éructe mille idées sans liens. Je m’assoupis à moitié, revois les images de la course cycliste Bordeaux-Paris, devant Saint Paterne, Orléans. Un cercueil se hisse sur la voiture des morts. Un coureur en trombe heurte, renverse dans son élan forcené, la funèbre boîte. Le crid d’horreur de l’assistance me sort de ma bienfaisante torpeur. Silence prodigieux, à peine troublé par le bruissement du feuillage. Deux sous-officiers accroupis discutent sur notre position incertaine. Ils ignorent où nous sommes, s’acharnent à flairer une carte vieille de vingt ans au moins, en viennent presque aux mains, incompréhensifs à la lecture des hachures topographiques. Finalement, ils ne tombent absolument par d’accord. Ces deux lapins n’ont pas l’air très à la page. Réserve, active ? Hier ils passaient leur temps à interroger les hommes ; pour un peu ils se mettraient à leurs ordres. Je me prends à songer à nos chefs de mobilisation, victimes de la surprise d’il y a dix jours. Que sont devenus braves badernes et ignorants pourfendeurs ? Le capitaine, homme paisible a reçu l’estocade de deux grenadiers ennemis. Le lieutenant, bilieux rossard, a été pris de plein fouet par un percutant filandreux. Le sous-lieutenant qui se vantait, en sa qualité de journaliste, de s’être payé les champs de bataille balkaniques, a trouvé la mort dans l’inévitable défaite qu’il nous avait prédite. L’adjudant " mon oncle ", adipeux tourmenteur de générations troupières, la bedaine blessée, a fini noyé. Le fils du général, l’aspirant ténébreux, loufoque sympathique, rengagé par manie de famille, a été tué en chargeant seul une brigade prussienne. Roulement de galops précipité. Les betteraves écartent leur ventre rondouillard sous la poussée de nos uniformes. Les culasses se meuvent.
- Nom de Dieu ! Gueule Durillon � sur le tournant.
- Préparez feux de salves !... Hausse 600�Joue� Halte� merde�, ne tirez pas ! Ce sont des Français, des artilleurs, signale le télémétriste mitrailleur. Il était temps. D’où diable sortent-ils ? Ferraillant, jurant, cette sacrée batterie nous croise en se défilant vers l’arrière. A sa suite nous reprenons une rebroussante marche saccadée sur la chaussée brûlante. Des chasseurs cyclistes aux fesses douloureuses viennent à notre rencontre, nous frôlent de leurs cuisses en canard pour aller à leur tour prendre la queue du cortège. Une côte se présente à nos jambes raidissantes. " Y’a de la goutte à boire là-haut ", chantonne une langue pâteuse. Une ferme. Halte. Le ravitaillement est à nos ordres. Viande, pain, conserves jaillissent des voitures pour nous tomber dans les bras. �a ne va pas encore assez vite. Pas de temps à perdre. On plonge dans le tas. Nous n’avons pas même remarqué la disparition de tout ce qui gravitait autour de la ferme pendant que nous nous ravitaillions. Trains de combat, équipages divers, tout s’est carapaté dans le dédale des bois environnants� jusqu’aux chasseurs cyclistes qu’on aperçoit pédalant à plein mollets pour se mettre " en potence " en aval de la ferme. Risque pour risque, nous ferons la soupe, dussions-nous être surpris au festin. Un boqueteau voisin offre abri, ses brindilles mortes qui vont pétiller d’abondance. Blocs de viande poussiéreuse, pommes de terre en robe crasseuse commencent à polker dans l’eau qui tressaute à la léchure des premières flammes improvisées. Recueillis comme devant des icônes, nos nez s’épatent à la reniflade des savoureux arômes. Une fusillade violente.
- Quoi qui gn’a, quoi qui gn’a ? Jappe Durillon. Saut dans le fossé, l’œil se hasarde. Les cyclistes mitraillent l’azur. Au-dessus de nous, à cent mètres, un Taube plane, rapace noir. Il tourne, fait mille grâces puis se propulse à tire d’hélice non sans landes quelques fusées-signal. La pétarade cesse. L’incident paraît clos. Un capitaine prétend avoir montré son poing à l’aviateur ennemi, " comme ça, à la française ".
- Le Pilote m’a certainement vu. J’étais seul au milieu de la route� Félicitations à la ronde. C’est une victoire. Cinq, dix minutes passent euphoriquement. Crevant le ciel, de sinistres hululements. Fracas terrible. Arbustes, branchages dansent la gigue. Des blessés galopent ou râlent. Le faucon noir a indiqué la bonne hausse.
- Aux armes, aux armes citoyens ! Bon dieu de merde ! Où ça cogne le plus fort, c’est là qu’il faut aller repiquer nos fusils. Bonds désordonnés sous l’averse de shrapnells. Les percutants disloquent la glèbe. Le capitaine, qui a montré son poing " à la française ", surpris sous la futaie en train de pondre, court vers son sabre, tenant sa culotte à deux mains. Maîtres de nos flingots, nous fonçons de nouveau sous les arbres, direction la route. Passant en bordure des marmites, j’agrippe une anse brûlante dans ma cavalcade. D’autres piquent à la baïonnette des morceaux de charogne gros comme des cuisses et se cavalent en mordant à la même chair et son piteux dégoulis. Pinton, qui changeait de nippes, progresse pieds et torse nu, les bras gonflés de son attirail vestimentaire. Les blessés geignant s’accrochent aux valides qui grognent. Porteurs de mangeaille et infirmiers bénévoles atteignent le chemin empierré. Le tir s’allonge ! Gare ! Tous à plat ventre ! Bras encerclant la tête, anus comprimé. De la ferme sort en trombe une carriole bourrée de matelas et de gens fuyant in-extremis au souffle de la canonnade. La voiture aura-t-elle le temps d’arriver jusqu’à nous en évitant les marmites qui tombent dru ? A coup de reins le cheval blanc allonge, allonge. A nous ! D’un bond nous traversons la route. Au même instant une volée d’obus se plante face au canasson. L’animal se cabre, secoue fébrilement ses pattes, s’abat en basculant par-dessus bord sa cargaison de choses et d’êtres. Jeté bas, avec ses parents, dans la culbute de la voiture, un moutard de trois ou quatre ans reprend seul le chemin de la ferme solitaire. Des soldats s’affairent autour de la carriole en capilotade d’où ils extraient des oies vives qu’ils fixent à leur ceinturon puis galopent sous les pots de fer dans un tourbillon de plumes et de pattes vengeresses. La gorge desséchée par ces minutes trépidantes, je me sens ému en cherchant à tâtons les formes dures de mon flacon de menthe, seul réconfort accepté par mon estomac contracté. Tonnerre ! Bouteille de menthe et musette ne sont plus que hachis lamentablement secoué au bout de la bretelle. Rien vu, rien senti. Joyau, au nez emporté par la ferraille. Dupré, au front troué, ont l’air d’avoir plongé dans un égout d’abattoir. Le capitaine au poing " à la française ", déjà à cent mètres, court dans les chaumes tenant toujours sa culotte que la rapidité des événements ne lui a pas permis d’ajuster. A son dos pendille sa liquette, panache jadis blanc auquel nous nous rallions en traînant la patte. Rompus par ces galopades, nous retrouvons la pierraille routière, les pommiers qui la bordent. A l’abri du ravin, le chef du bataillon et son adjoint Cambuson, yeux fronçillant devant notre indifférence, veulent secouer notre tas d’engourdis. Hâtif regroupement des unités. Attention pour l’exercice.
- Lignes de sections ! Face à la route ! ... Baïonnette au canon ! Tonne le sous-lieutenant Bellejambe.
- Baïonnette-canon ! ordonne Bellejambe tout troublé de tant de précision. Fureur de Cambuson.
- Baïonnette-on ! Baïonnette-on ! Recommencez ! Apostrophe Cambuson.
- On doit dire�. on� on. Baïonnette�on�on�on !
Vous entendez lieutenant, c’est le nouveau règlement ! Bellejambe se fâche, rougit, rugit, ce qui nous permet de dormir debout cinq bonnes minutes. Flasque comme nouille cuite sur son cheval de fiacre, ficelé dans sa tenue de 14 juillet, le capitaine de réserve, chef de bataillon, roupille à l’unisson. Coupant court à ces loufoqueries, les obus de toutes espèces se remettent à tomber. Le capitaine et sa jument sortent de leur torpeur. Cambuson ébauche soudain une pathétique harangue.
- Messieurs, messieurs ! Une sueur froide m’envahit ; les baïonnettes oscillent, les hommes s’interrogent d’un regard glissé. Il a bien dit " messieurs " ! Car il le répète. Quelle félicité pour nous. Nous en tombons presque sur séant. Cambuson poursuit :
- Le combat va s’engager� crête militaire� contre-attaque� tapons dur. Sur cet avant-goût de sacrifice, en avant ! Il nous reste peut-être encore une heure à jouir du ciel vu d’en bas avant d’y élire domicile pour l’éternité. Un dernier regard sur dix petites choses de rouge et de bleu vêtues, recroquevillées, inertes au flanc de la route. La compagnie bourrée de cartouches avance sur son chemin de croix, lourdement, dans un quasi-silence. Mon voisin tripote furtivement un chapelet. Un autre tasse des cailloux dans son portefeuille pour se protéger le cœur. L’un des piqueurs d’oies marche au canon avec sa proie qui perd ses plumes, braille à bec ouvert.
- Si seulement on avait la vie aussi dure que c’te volatile, commente le sergent- major qui depuis ce matin trimballe sur l’occiput en guise de bouclier une énorme cuvette de fonte prélevée Dieu seul sait où. Personne, pourtant, en ce solennel instant, n’a le cœur à rire de ces précautions. Le lieutenant a bien installé, dans son képi, une boîte à conserves soigneusement aplatie. Un blessé allemand, capturé ce matin, cachait sa panse derrière une cotte de mailles. Un ordre :
- Manger ! Tout se passe au commandement. Ne nous a-t-on pas mis déjà dans l’obligation de pisser en marchant �
- Manger, Quoi ? La boustifaille du marin a été semée avec les gamelles tout au long de nos évolutions décousues. Quelques-uns se prennent à grignoter nerveusement pommes vertes, biscuits, re-pommes. Quelques autres ne veulent rien savoir :
- Tu comprends, si j’étais blessé au ventre � A un coude de la route se dresse soudain une maisonnette au mur de laquelle, à l’anneau, piaffent deux chevaux superbement équipés.
- �a pue le général ici.
- Face à gauche ! En tirailleurs ! Une haie épineuse. Il faut quand même passer. Coups de pied, coups de crosse nous ouvrent quelques maigres coulés où de gras réservistes restent prisonniers de ronces tenaces comme lièvres solognots dans des collets maigres. Les croquenots bousillent platebandes de céleri, cloches à melons. En avant ! Pour l’autre rive du potager !
Encore une haie à détruire et � des boîtes de paille. Ces paysans ont de drôles d’idées. Coups de crosse. De la paille s’échappent des masses bourdonnantes. Gueulantes. Les abeilles se vengent. Cent hommes se ruent, se heurtent, se renversent. Les mouches à miel se calment. Trente secondes ont suffi pour transformer la paisible fabrique à légumes en capharnaöm. La haie franchie : champs vides, sillonnés de tranchées individuelles. Remontent-elles à 1870 puisqu’il n’y a personne devant nous, sauf les Allemands. ? Notre ligne de tirailleurs ondule comme un serpent inquiet. Ici dix hommes s’entassent. Là, un homme tous les cinquante mètres. Nous tombons au revers du talus d’un maigre ruisseau. �a alors ! Toute la lisière est imprégnée de merde fraîche. Sans cet inattendu, la position serait excellente. Une vraie tranchée. Finette en est exaspéré. A nos côtés se pointent mitrailleurs et mulets. Ces derniers réfractaires au saut du ruisseau. Les servants tirent les brides à s’en tordre les poignets. D’autres poussent les bêtes au cul. Rien à faire. Pour corser l’affaire surgit en trombe une escouade d’obus de campagne. Du coup les mulets se collent sur le dos, font camarades de leurs quatre pattes, ne veulent pas mourir encore.
- En avant ! Un long bond. Halte ! En carapace ! Foumroumpoumpoum ! Laissons passer cette réception. Nouveau bond qui nous porte au taillis en avancée du massif boisé. A droite un groupe se rapproche. Des Franz�se d’un autre bataillon qui viennent de tirailler pendant un quart d’heure.
- Ah, mes salauds ! Qu’est-ce qu’on leur à mis ! Un de ces braves assure avoir brûlé sa trois centaines de cartouches. Leur jactance ne nous trompe pas et nous sentons fort bien leur trouble à les voir rôder parmi les souches pour poser culotte. Que de derrières en activité ! Pommes crues ou trouille ? Un adjudant scrute son épée sanglante et ne comprend pas d’où sort ce sang : Ordre :
- Tournez le bois par la gauche ! Nous débouchons sur une crête aguichante atteinte après une pénible grimpette. Quel magnifique champ de bataille � possible. Un colonel d’état-major en jubile. Nous les soupçonnons d’avoir présidé au choix de ces positions.
- Ah ! Ah ! Mes aïeux ! S’exclame-t-il avec ardeur, en se grattant le reniflard. Ah ! Ah ! Mes aïeux ! Sa jumelle sonde le large : bois, village, église, vallon coupé de routes, obstrué de haies, les crêtes nord, la ferme et son mur à créneler. Rien n’y manque, même pas le soleil d’Austerlitz. Le bois que nous avons contourné sert maintenant de reposoir à une torchée de gros obus en goguette. Des arbres géants se dandinent comme des quilles avant de s’étaler sur les hommes du premier bataillon.
- A nous la 5� ! Pour un bond ! Tous à croupetons, genoux sous le ventre ! Hop ! On y va � En plein découvert, ma mère ! Cinquante mètres de plus direction l’Allemagne. On ne voit rien sinon les gerbes des 75 qui à plein débit pilonnent le coteau d’en face. Tsé ! Tsé ! Tsé ! Clac ! Clac ! Tsé ! Mille balles chantouillent à nos tympans sensibles. Chfuit ! Chfuit ! Chfuit ! Les assassines nous frôlent, gambadent autour de nos carcasses. En voilà une qui a enfoui son museau froid comme un coup de trique en plein dans mon sac. Celle-là perce la crosse de mon fusil et mon bidon d’où l’eau chaude gargouille pour asperger ma hanche. Impression de sang qui pisse. Soudé au sol, le bonhomme à ma gauche se ratatine, se pelotonne, vrille son nez dans la terre, serre son crâne contre le soc de la charrue qu’il a transbahutée avec peine depuis le jardin aux insectes piqueurs. Fier gaillard pourtant que ce redresser du 1� mai qui nous contait il y a quelques heures à peine comment on bousculait les civils à coups de pied et de casse-têtes, comment on traînait les femmes par les chignons, etc� Ici il geint et se fourrerait dans le colon d’un rat si cela devait lui assurer le salut. Obus sur obus débarquent comme pluie de grenouilles, crevant les chairs, broyant les os. Un officier éventré me sert de rempart. Quelle curieuse chose que ce champ de bataille. Pas d’adversaire visible. Où est le Prussien ? Inutile d’user ses cartouches. Le règlement est formel.
- Quand on ne voit pas le gibier, faut pas tirer, disait le sergent Bedoufle. Par contre, à portée de regard de myope, les Français gigotent sur l’herbette dans leurs extravagantes livrées d’écrevisses cuites. Naturellement il me vient à l’esprit l’image de cette commission de bedonnants experts qui s’était transportée sur le champ de manœuvres pour juger de la visibilité des nouveaux uniformes préconisés. Le rouge en était complètement banni. Un général avait alors laissé tomber cette froide et définitive sentence :
- Un soldat français sans pantalon rouge, c’est comme la plus belle femme du monde sans poil au c� Et le pantalon rouge resta. Nouveau bond ! Galopade réduite ! Où sont donc ces irrésistibles bondissements prévus dans les manuels de fantassins au combat ? Les balles pleuvent comme grêle faucheuses. Des corps roulent au sol en de grotesques clowneries. Les possesseurs de sacs, les heureux, s’en font de dérisoires boucliers. Tous n’ont pas la chance de Durillon dont le ventre est enfoui dans la concavité de sa cuvette de fonte et qui joue à la femme enceinte courant à couche prématurée. Dernier bond cependant fameux même si nous avons laissé de la bourre. Le policier 1� Mai n’est plus là. D’autres non plus. Tués ? Blessés ? Cachés ? Un coup d’œil en arrière : de petites choses sombres que les obus se retournent comme des escalopes. Des estropiés se traînent en cul-de-jatte. Une ligne de tirailleurs progresse vers la droite. Flammes vertes, roses lèchent un coin du village où les obus de chacun se donnent rendez-vous pour une gigantesque sarabande. Ventre à l’humus, côtes à côtes, palpitant comme métronomes déréglés, alignés comme à la morgue, on est encore dans le coup.
- Devant vous un clocher ! Vu ? ...
- Vu� Vu� Vu� Vu !
- A deux doigts à gauche du clocher, à mi-hauteur une haie � Vu ? Vingt mains se portent au quillon du fusil
- Attention ! Je répète. Faites passer � serine Durillon guilleret. Un garçon épicier répète tout de travers. Il prétend voir la Sainte Vierge. Le sergent-major qui en a plein les oreilles interpelle le délinquant. Rien à faire. C’est un " tapé " subit que nous abandonnons à ses jérémiades. Bon sang ! La jumelle a vu juste ! A deux doigts du clocher, ça bouge manifestement derrière d’équivoques verdures. Plus loin, de Commanches font de la reptation dans les blés et les avoines. Plus de doute possible : les pousse-cailloux des sections prussiennes dont une partie dévale, fesses à la glaise, un vertical layon ! Le braconnier solognot torche une humidité dans l’œil.
- C’est pas la trouille mon gars, mais ça me fait drôle de jouer les Pruscos !
- Hausse 650, 650, 650. Feux de trois cartouches� Feux ! Quel effet ?
- Hausse 600, par salves ! A mon commandement, Feux ! Là-bas ça s’agite. La hausse est bonne. Mais ceux du bas avalent la distance, pas pour nous féliciter.
- Attention ! Sur ceux du sentier ! Feux à volonté. Le Solognot, professionnel du fusil, se croit en battue officielle tant ses étuis voltigent dans les betteraves impavides. Le soleil cuit le dos. L’acier brûle les mains. Les visages ruissellent. Gorges rêches. Bidons vides. A boire. A boire ! Un éclat large comme la main vient s’affaler sur ma hausse. Les faces suantes s’arrachent une seconde à la terre. Les yeux fouillent le terrain palpitant. Nos bras-pistons manœuvrent les culasses mobiles.� Mille abeilles de fer foncent au malfaisant labeur. A 200 mètres devant oscille une meule de paille.
- �a pouge là-tetans. Feux, feux, feux ! Tout le monde commande. Tout le monde hurle. Une nichée d’allemands prend son vol au ras du sol direction un proche remblai. Des mitrailleuses gloussent sans répit. Feux ! Feux sur la fenêtre. Pim ! Pim ! Pim ! Pim� dans le rectangle meurtrier. La bavarde va papoter ailleurs. L’autre mitrailleuse agrippée au clocher comme un chat à son tronc de pommier dégringole avec le porte-cloches sous les hennissements têtus des 75. La voie semble libre.
- On avance ? Oui ? Non ? Oui ! En avant !
Les obus qui nous précèdent tissent leur marée métallique.
- Couchez-vous ! Nous nous cherchons, serrés en moutons sous l’orage ! La chaleur du copain nous empêche de nous sentir seuls. Nous ne sommes plus qu’une douzaine à représenter la section. Baucheux, avec un Oh-là-là tragique, a sombré dans les betteraves. Cardot a crié :
- J’en ai dans le buffet. Les autres n’ont rien dit. Pas le temps de s’attendrir. Notre tour viendra. En avant !� Perçant la fumée environnante, hurlements d’assaut.
- A la baïonnette ! En avant ! A la baïonnette ! Qui a lancé cet ordre ? Il y a donc encore des chefs ! Les hommes gris, d’en face, chargent.
- En avant, ouah, ouah, ouah ! Durillon a envoyé rouler sa cuvette. Sabre au clair, il gueule et court écartant les cuisses en cavalier prostatique.
- Ouah, ouah, ouah ! Kraft ! Kraft ! Baoum ! Bang�Explosions. Sifflements. Pétarades. Déluge. Tonnerre sur la tourbe rugissante. Les deux adversaires prêts à s’encorner tournent bride en une fuite éperdue. La grosse artillerie allemande brusquement démasquée à l’instant où les 75 se refroidissent un peu, dresse de toutes ses pièces une infranchissable barrière d’acier. Pantalons rouges, casques à pointe, tourbillonnent dans des geysers fumeux, culbutent, braillent, dégueulent leurs tripes. Les rescapés galopent. Un tronc humain rampe à mes pieds avec ses résidus de jambes.
- Je voudrais être crevé ! Soliloque un grand diable aux pansements vermillon qui n’a plus que mauvais pantalon et chemise. L’instinct lui a fait bourrer les poches de cartouches. Deux déprimés geignent comme des gosses. Les plus lucides vocifèrent contre notre artillerie qui se tait. Un rouquin me crie mieux connaître son métier de boulanger que celui de fantassin. Enfin, la corne du bois protecteur ! Nous nous consolons de l’échec de notre charge furieuse quand nous apprenons qu’un ruisseau perfidement caché dans les hautes herbes au dernier instant aurait rendu nos baïonnettes trop courtes. Exceptés deux ou trois subalternes, entourbillonnés dans notre horde, aucun supérieur pour nous montrer ses moustaches. Nous parcourons de douces ondulations pour nous heurter au commandant du 2� Bataillon qui traîne solitaire sous les pommiers en fumant la pipe, attendant des nouvelles de sa troupe en vadrouille. Le commandant nous aide à cueillir les fruits. Il écoute avec une visible satisfaction le récit des faits d’armes dont certains l’abreuvent.
- �a marchait bien les enfants� �a marchait bien � sans ces maudits obus� Et de croquer à belles dents dans sa verte récolte.
Poussons donc l’audace à nous asseoir en rangs d’oignons tandis qu’une ligne de diarrhéiques macule le pied de la haie voisine. Brefs instants de douce détente avant que ne débouche le général de brigade, le Vieux à plume blanche. Pas un officier à ses chausses mais un quarteron de pleurnichards qu’il a pincés loin de tous en flagrant délit de retraite accélérée. Les malheureux font protestation de leur dévouement, accusent l’artillerie, les voisins, les morts. Celui qui crie le plus fort n’est autre que le policier-boxeur disparu depuis des heures de la ligne de feu. Le général n’entend rien, ne veut rien entendre. De nouveau, chef de section, suivi de son troupeau confus, il pousse sa jument sous les frondaisons, avance droit aux chiasseurs, les exhorte à se reculotter, à marcher au combat. Presque aphone, dressé sur ses étriers, le Vieux proclame la revanche.
- 2 septembre, 2 septembre !... La revanche de Sedan !... En avant les enfants !... Une branche catapulte son bicorne dans les bruyères qui conservent la plume blanche. Accourt le lieutenant, adjoint au chef de bataillon. D’où sort-il ? Le bougre n’a pas l’air spécialement ému � Quelques menaces aux chefs de section :
- Pas la peine de reformer les unités � Pas de temps � colonnes par deux, en avant, pour ravitailler la ligne en munitions � Prendrez les cartouches au caisson, derrière le bois� Marche ! C’est bref ! Tout le monde a compris sauf � le général qui continue de piailler la revanche, avance dans le sens contraire à la marche puis se ravise pour galoper en tête.
- Décidément, ils ont juré de nous faire tuer �crache une voix colérique. Le cortège s’engage dans un bocage. Tiens ! Tiens ! A l’abri d’une mignonne clairière le Colonel ! D’autre Colons ! Une nuée d’officiers ! Un vrai concile de pingouins. La vue du vieux général convoyant leurs hommes vers la ligne de feu les plonge dans un bel étonnement sans les tirer de leur perplexité.
Caisson. Ravitaillement. Interminable distribution. Quelques hommes de queue en profitent pour rétrograder sous bois et nos loustics reprennent intérêt au caisson munitionnaire. Un cheval qui piétine ses tripes s’assoit enfin sous le coup de grâce. Voûtés sous les kilos de cartouches, nous nous traînons lourdement vers une imprécise destinée.
- Couchez-vous ! Couchez-vous ! Devant moi un chêne touché dans ses séculaires assises par une fulgurante, bondit dans l’espace, ses grands bras étreignant le soir qui tombe. Des mitrailleurs saxons défendent l’un des murs de la ferme là-bas comme si c’était une propriété personnelle.
- Avancez ! Mais avancez ! Tas de salaud, froussards : vocifère la voix d’un colon d’état-major, recroquevillé dans le fossé de la route. Double-mètre. C’est Double-mètre, fameux dans notre ville de garnison autant par sa taille que par sa méchanceté professionnelle. Revolver au poing, le dogue menace quiconque tenterait à son exemple de se garer du flot des balles. A ses côtés, à ses ordres, caché derrière un arbre, un fantassin pointe son arme sur les hésitants. C’est encore le policier-boxeur. Comment a-t-il récupéré cet emploi malpropre qui l’aide à abriter sa charogne. Un réserviste, dans sa course en avant, casse son bandage herniaire et reste cloué au sol par son infirmité débordante. Aussitôt les deux compères surviennent et à quatre pattes, prêts à un assassinat pour l’exemple. La vue de nos fusils, subitement intéressés, invite les deux larrons à regagner leur repaire.
Mais ces cochonneries de capons zélés sont du plus désastreux effet sur des hommes qui en oublient la guerre pour parler de tirer sur ce nid de vipères qui veut racheter son impéritie par des canailleries satrapes.
Il faut le raffut du canon pour détourner leur haine qui grandit. Mon fardeau cartouchier lessivé, je me retrouve allant de l’avant dans un salmigondis - ahanant sous l’effort - de fantassins de tous crus, de chasseurs à pied et de coloniaux. Un Saint-Cyrien ganté court en guidant cette salade arlequinesque. Courte progression. Brutal, un éclair. Kraft ! La volée de shrapnells s’est vidée sur nous. Des copains dégringolent.
- Plus vite : Plus vite ! S’égosille le Saint-Cyrien sans remarquer le barbouillis sanglant qui recouvre son épaule et sa manche.
- Monsieur l’aspirant, vous êtes blessé ? L’interpellé se regarde, voit le sang, pâlit, s’affale au sol, roule sur le dos en hanneton. De sa gorge monte une héroïque litanie :
- Je meurs content, c’est pour la France ! Je meurs content, vive la France !
Il a quelque chose d’empoignant, ce chant du cygne. A croupetons, au chevet du martyr, nous vivons une émouvante minute.
- On ne va pas le laisser comme ça, décrète un colonial qui, d’un coup de lame à virole, dépouille le moribond des parties ensanglantées de l’uniforme, pour essayer un pansement. Stupéfaction ! Quelque massacré de la dernière bordée à dû fournir le matériel liquide. Le Saint-Cyrien, ravigoté d’un coup, retombe sur le cul, pâmé de honte. Il a tort. Nous nous foutons de ce sot amour-propre. Au diable, en cet instant, les affres de l’état-major, la patrie menacée, la veuve et l’orphelin. Il n'y a pas de paladins ici mais des bipèdes recrus de fatigue et de soif n’aspirant qu’au repos ou à un impossible breuvage. L’ennemi bouté hors de la ferme protège sa fuite par des rafales de mitrailleuses. Les chapelets de balles mutilent les corps sans vie, nous harcèlent dans les topinambours ravagés.
Montignac lève la tête et meurt. Cavignol, le clairon qui nous apporte un ordre, va repartir mais s’écroule les jambes sciées. Des êtres vidés de sang, des positions biscornues, l’œil chaviré par l’épouvante finale, soutiennent une meule de paille. L’un d’eux à quatre pattes, tignasse au sol, traîne ses intestins. A leur tour, les mitrailleurs allemands lâchent pied, les servants détalent affolés, offrant la cible imposante de leurs omoplates à nos réflexes fatigués. L’un d’eux croit retarder le moment dernier en courant en zigzag, mais est fauché dans sa galopade de lièvre intelligent. Plus loin dans les profondeurs boisées, une génération d‘arbres s’écroule. Nuit ! Des groupes ténébreux viennent battre les abords de la ferme pour dénicher de l’eau. Le puits est consigné, suspect de poison. Quatre hommes le gardent farouchement dressés sous le clair de lune. Les disponibles vont aider les brancardiers, fouillent les coins où sont allés s’encastrer les blessés dont les appels trouent l’obscurité.
Un Allemand, le poitrail percé, geint au pied d’un calvaire. On le panse. Il est stupéfait de s’entendre interpeller dans son rude langage. Deux Alsaciens font savoir qu’il a soif.
- Qui a à boire ? Silence. Cambuson sort son revolver et inspecte les bidons sous le regard du Christ en fonte� Le blessé avale son quart d’eau, ultime réserve de l’un de nous. Débouche un groupe d’allemands prisonniers non blessés encadrés par cinquante baïonnettes. A leur tête sautille une espèce de morveux à monocle. Un officier ? Le passage de ces hommes gris au casque imposant sous les rayons lunaires nous fait forte impression. Appel ! Après la bataille, sorte de criée nocturne, jettent des chiffres, implorent, menacent. Au fond du vallon, le village grille. Dans le lointain, le canon aboie hargneusement.
- Faut que je beuve. Je te dis que j’ai trop soif ! Pleurniche Grimoire. Il décide d’aller à l’eau vers le patelin en feu. Pendant quelques instants, je suis des yeux son dos bosselé qui s’enfonce dans le chemin creux. Je ne le reverrai plus. Toujours des voitures à bras qui passent, repassent, drainant des chairs pantelantes, au milieu de paquets d’hommes glacés par la mouillure nocturne, étendus dans les sillons de betteraves, fraternisant avec les morts. Fuyons l’engourdissement du premier froid de cette guerre. Tout baillant, j’arrive au sommet d’un tertre où se détachent quelques silhouettes abasourdies devant l’horizon en feu. Tout baillant, j’arrive au sommet d’un tertre où se détachent quelques silhouettes abasourdies devant l’horizon en feu. Des villages lorrains dissipent au ciel leur centenaire substance. Quelques pas en avant du groupe, un isolé statufié débute d’incohérentes paroles. J‘ai beaucoup de peine à reconnaître Montelet, caporal des pompiers dans le civil. Montelet est en ce moment, pour sûr, loin de la guerre. Son crâne de paysan tinte de bruits de seaux de pompes, de haches. Impuissant devant ce fléau, il geint. Du groupe, jusqu’à présent silencieux, partent des rires.
En route ! L’aurore se débarbouille. Il est dur le premier kilomètre à nos jambes ankylosées. Avec peine nous distinguons le feuillage qui nous escorte. Nous progressons ver une trouée claire. Une vallée sous un édredon de brouillard filasse. Le jour qui s’enlumine nous montre les gouttes de rosée sur la verdure. Aussitôt cent langues s’allongent pour un léchage méthodique. La colonne stoppe. Foin de discipline.
- Si jamais les Boches arrivaient ! Ce serait du propre ! énonce le sergent Finette qui transporte deux bidons pleins d’un mystérieux breuvage.
- Veinard ! ...� Finette, flairant alors la convoitise qu’éveillent ses deux litrons, nous conseille de prendre notre temps car il y a sûrement une arrière-garde. Mais à propos, où sont les gradés ? Se sont-ils tous fait tuer ? Cinq cents " deuxième classe " sont bien tombés! Ce qui semble sûr c’est que Riétri et Ponticelle, les deux rempilés corses, ont sombré sous les balles folles. Dormez en paix, insulaires ! Je vous haïssais presque autant que ceux d’en face, tas de Poléons au petit pied... Un chemin en tire-bouchon nous conduit jusqu’à un minuscule hameau où règne une fébrile agitation. En quatre pelletées, des brancardiers recouvrent des corps extraits de la maison " poste de secours " qui dut fonctionner hier à plein rendement. Les pelles s’éloignent : deux pieds émergent encore.
Halte ! La compagnie se pose sur un terrain pentu, peu propice à l’implantation des faisceaux. Les flingots valsent où ils veulent. Ruée vers le puits proche où une douzaine de lascars déjà installés sont prêts à la bagarre fratricide. Inutile de parlementer. Des cuves ramassées dans une maison abandonnée aident au partage décent de l’eau pour préparer le café ! Quel café dans ces bacs puants et graisseux qui fournissent à la fois le manger et le boire. Belle jambe s’en indigne, ce qui ne l’empêche pas à son tour de jouer des mâchoires pour s’enfiler l’horrible mélasse. Malheur ! Quinze minutes suffisent à cette lavasse pour accomplir le périple de nos intestins mal assurés. Malheur ! Quinze minutes suffisent à cette lavasse pour accomplir le périple de nos intestins mal assurés. Une brochette de tubes digestifs bombarde déjà le fossé de la route. Vingt mètres plus bas, le drapeau du régiment, piqué au faîte d’un triangle de Lebels, dort dans son étui de moleskine sous la garde d’un gradé crotteux qui se bourre de cacahuètes. A ses pieds, un saucisson agité terminé par une visière. C’est le colonel ficelé dans une couverture à ramages. Il partage la rude existence de ses hommes. Durillon qui a passé la nuit à grelotter ouvre des yeux admiratifs. Pour son chef ? ... Non pour la couverture. Couché sur mon ventre douloureux, je tombe dans un demi-sommeil quand une imprécise harmonie chatouille mes oreilles lourdes. J’ai entendu çà quelque part. Où ? Mais Oui! Une nuit ! ... Les Allemands de l’autre côté de la Meuse ! ... Nom de Dieu ! Un saut de carpe me jette sur les genoux. Toute la compagnie m’entoure calmement. Des Alsaciens serinent sur leur harmonica de vieux lieds germaniques. Epargnés par la colique, ils fêtent notre succès d’hier. Les voici rassurés pour quelques heures. Le trouble commençait à travailler ces volontaires de huit jours dont quelques-uns appartenaient à l’active allemande trois semaines auparavant. Quels instants de terreur vécut hier Hornig quand il repéra le régiment impérial qui retient encore son frère !
Colonel, aide-marmitons grimpés sur leurs rosses foncent ventre à terre, vers l’arrière accueillant, dans des tourbillons poussiéreux. Des colonnes d’infanterie en marche accélérée apparaissent puis s’estompent dans le même écran gris. A notre tour, nous reprenons le sempiternel et inexplicable repliement.
- Pourtant, s’étonne Jolicoeur, les Boches ont reçu la fessée hier. Jolicoeur a jugé bon de jeter son képi et de le remplacer par un casque allemand. Les Alsaciens regardent avec mépris ce Parisien couronné des aigles du Kaiser.
- Vite. Plus vite ! Les Boches ont repris leur course en avant. C’est à travers les chaumes, en lignes de sections, qu’il nous faut rétrograder. Un conducteur obstiné charge sa carriole : blessés, équipements, fusils, s’empilent encore que déjà les uhlans patrouilleurs s’expliquent avec les cavaliers d’arrière-garde. Nous nous préparons à faire demi-tour pour châtier les importuns mais l’adjoint au bataillon, soudain impératif, jette :
- Continuez la marche !
Le lieutenant Bellejambe a vibré sous l’outrage et nous assistons à une altercation semblable à celle qui mit aux prises ces deux officiers l’an passé à la caserne. Cambuson s’éloigne au galop de sa monture. Nous continuons la promenade imposée, l’arme au bras, comme derrière un corbillard. L’allure nous laisse tout loisir de nous observer les uns les autres. Torlequin, petit-fils d’un Gravelotte, propose d’incendier les meules convoitées par l’ennemi. Il en crame une aux cris de :
- Encore une que les Prussiens n’auront pas ! Et manque d’être assommé par les paysans de la compagnie. Le lieutenant Bellejambe ne s’intéresse plus à rien. Tout à son altercation passée. Il rumine, rumine. Tout à coup, il explose :
- Moi un homme du monde. Moi un officier de valeur, me faire donner des ordres par ce rustre, par ce croquant mal dégrossi�
D’une langue qui gagne en verdeur, il démolit son prestige d’officier et nous laisse deviner son âme de pauvre bougre jalouse à crever de la bonne fortune du copain qui a droit à � un cheval. Je suis bercé par cette homélie vengeresse et dors en marchant pendant quelques kilomètres. A quoi bon faire écho à ce salarié de la revanche. Si quelqu’un se sacrifie entièrement, ce n’est certes pas lui.
Sur le sommet de Montfaucon, un régiment français, surpris en formation de route par une tempête d’explosifs, se disloque. De petites poupées bigarrées s’éparpillent sur les versants, derrière l’écran de fumée bleuâtre. Durillon paraît interloqué. Se croit-il donc aux Grandes Manœuvres ? Mais aussitôt ressaisi :
- Marchons mes amis. Marchons. Nous ne pouvons rien. Chacun son rôle. Chacun son tour� J’ai toujours eu de la sympathie pour ce vieux " rempilé " qui n’a jamais su punir personne et fait montre d’un caractère égal à la guerre comme à la caserne. En dépit de ses deux pieds mal rabotés, qui lui valurent cette appellation, il porte sabre et sacoche avec beaucoup de majesté. Une bedonnante sacoche bourrée de documents de la compagnie. �a n’est plus un combattant, mais une archive ambulante.
Quelle aberration de nous crever en efforts inutiles sur ces terrains impropres à la marche alors qu’à vingt mètres s’étire une route superbe libre d’hommes et de matériel. L’ennemi, pas si bête, l’utilisera tout à l’heure. Cette façon de mésuser les troupes est bien militaire. Nous nous en ouvrions à Bellejambe qui partage notre avis mais ne peut rien changer à l’ordre de marche. Pause. Assommées par des crosses, les branches de pommiers lâchent leurs fruits aigres aussitôt enfournés en d’avides mâchoires. Durillon déclare qu’il n’y a pas de boutons de culotte pour résister à ce genre d’assaut. Dix fois depuis ce matin, il a dû prendre la position de poule pondeuse.
- Si seulement l’état-major avait prévu la fourniture du papier ! Gémit-il hypocritement tout en tirant à contrecœur à chaque opération, un papier de sa chère sacoche ! C’est un privilégié au regard de nous, qui n’avons que les cailloux de la route. Au mitan du bourg, un gros ruisseau arbore un pont pansu comme diamant annulaire : des carrioles s’y dressent en barricade. Des énervés s’y houspillent. Où passer, Il y a bien un étroit goulot mais notre meute impatiente ne saurait s’en satisfaire. C’est la ruée. Horions. Panique. Des hommes tombent, estampillés par les clous des semelles. L’œil hagard, un dragon menace d’estoc et de taille quiconque chercherait à lui ravir la place. Une poussée magistrale balance le doux dingue au royaume des poissons. Laissons ces affolés.� Cinquante mètres plus bas un gué nous permet de traverser à mi-jambe une eau tiède où il ferait bon s’étendre. Sur l’autre rive, les maisons vidées de leurs habitants en fuite regorgent de pillards de toutes armes qui fouillent de la cave au grenier. On en voit qui tirent par les oreilles des cochons hurleurs, ou galopent maladroitement derrière une volaille terrifiée ou vident les tiroirs et dispersent au vent les familiales reliques. Nous passons devant une fenêtre à l’instant où une énorme pendule lancée par une main puissante vient s’écraser contre une armoire à glace dans un fracas d’éclats de verre cassé et de rires brutaux. Devant la dernière maison du patelin, des braillards s’acharnent contre un tonneau qui met de la mauvaise volonté à livrer son contenu. Nous nous dégageons enfin de ce paisible ramassis de maisons martyrisées.
Plus question de Verdun. Nous lui tournions carrément les talons. C’est à Paris qu’il faut aller défendre la place� � Paris ! Le mot miroite aux yeux des Parisiens pataugeant dans la brousse. � Paris ! � Paris ! C’était " � Berlin " il y a deux semaines. Du coup, des voix s’élèvent, presque mélodieuses. Jolicoeur, entre autres, tient le moral.
- C’est à Tombouctou qu’on va, répond-il à quiconque pose l’inévitable question. Puis il se met à beugler les airs scabreux de la capitale. Coiffé de son casque à pointe, il va faire une triomphante entrée sur les grands boulevards. Son menton broussailleux en tremble d’aise et de cadence. Le chef du régiment, intrigué, ravi, par ce chant puissant, s’arrête. A la vie du vieux, Jolicoeur redouble d’allégresse, mais quelqu’un somme brusquement notre nouveau Fragson d’enlever ça de sa tête ! Jolicoeur résiste à cette intimation. Un officier d’état-major, d’un vigoureux coup de sabre, fait voler dans l’ornière la cloche de cuir bouilli. La cadence se maintient. La journée s’annonce dure. Les costauds filent à un train soutenu.� Le reste flotte à l’aventure, au gré de son éreintement, traîne les tibias, se déculotte pour la centième fois. Vivantes bornes sur l’interminable ruban empierré qui s’enfonce vers la capitale. Depuis plusieurs jours, nos cerveaux vivent dans l’ignorance totale des évènements et sont engourdis par une parfaite indifférence. Presque pas de réactions devant cette marche à l’envers non inscrite au programme.
- T‘en fais pas ! A Perpignan, sûr qu’on s’arrête !
- Que va faire l’ennemi, face à l’escadre de Toulon ? s'inquiète Cavignol. Du soldat. Rien que du soldat. Bizarre impression. Mais où sont donc les civils ? Plaines grillées, frais vallons, maisons solitaires regorgent de pantalons rouges mais pas un seul jupon, pas de casquettes. Durillon a l’impression qu’on nous laisse seuls avec la guerre et s’en afflige ouvertement. A la sortie d’un hameau sis sur la hauteur, nouveau contact avec le bataillon écrasé dans l’herbe jaune : soixante hommes attendent les laissés pour compte qui rappliquent peu à peu, regagnent lourdement leur place et seront de nouveau lâchés après deux kilomètres. Je suis maintenant de cet essaim en mal de ruche. Un officier à la tête d’une arrière-garde nous dépasse puis se ravisant nous invite à le suivre. Devant notre impuissance, il nous prie de surveiller notre arrière.
- Soyez tranquille, lieutenant, allez en paix� et que Dieu vous bénisse ! Raille quelqu’un.
A peine cinq minutes écoulées que des uhlans viennent parader sur nos croupions. Une salve de Lebels nous libère de ces indésirables qui se sauvent aplatis sur leurs grands chevaux couleur corbeau. Dans les instants qui suivent, me voici de nouveau impitoyablement lâché par les camarades forçant l’allure. J’accroche péniblement une équipe de mal foutus que j’abandonne, avec un sursaut, à leur détresse sur la route qui plonge maintenant sur Varennes. Varennes. La grand’place. Les maisons, l’église sèchent au soleil. Une femme juchée sur une voiture arrime des paquets. Aura-t-elle le temps de fuir ? Une immense vasque-fontaine invite puis repousse de toute son eau crasseuse. Je me cogne à un fantassin qui se lamente devant une cambuse. L’interpellé, sorti de son extase, me fait part de l’émotion qui l’étreint à la vue de la maison où aurait été arrêté Louis XVI. Un royaliste, sans doute, Derrière le pont, en tous cas, les gendarmes de la République nous guettent. Ces braves ne paraissent pas dans leur meilleure assiette à opérer aussi près du canon. Mais le général de division veut avoir tout son monde en � colonne. En colonne, donc, pour continuer la parade ! Des officiers pris parmi les deux ou trois cents traînards nous encadrent. Marche ! La grimpée cadencée, pour nous évader du village, commence. Tout beau, bien carré dans sa chaise, face à l’hôtel du Grand Monarque, son excellence divisionnaire, barbichu, bedonnant, préside à la revue du convoi en tapotant affectueusement sa cravache au museau du Boche dont l’arrivée est imminente. L’Etoilé ne voit pas l’atroce calvaire que sa fantaisie de vieillard impose à ses officiers d’état-major moites de peur, qui regardent anxieusement leurs autos aux portières ouvertes et aux moteurs déjà hoquetants. Deux de ces messieurs trouvent que nous n’allons pas assez vite par la faute de notre désordre. L’un frappe d’un poing rageur, l’autre dirige son revolver vers des tempes effrayées. Où est donc le manquement de leur discipline qui justifierait de pareils écarts ? Les hommes grommellent des mots terribles. C’est ainsi qu’on respecte notre effort, c’est ainsi que les maquereaux de la République agissent avec ceux qui les gavent et se battent à leur place ? Préparons nos cartouches puisque l’ennemi est également parmi nous ! Si ce chien crevé revolvérise quiconque, il mourra sur le champ et sa camarilla avec. La rage collective ne connaît plus de bornes. Les deux vauriens comprennent, rengainent menaces et revolvers, rejoignent leur patriarche � Jolicoeur jubile. Il n’est plus seul à trembler de haine car chaque heure voit se renouveler les motifs de dégoût. L’Alsacien Hausbergen semble atterré.
" Laissons " ! Sermonne un vieux territorial oublié de ses copains. Ce père de famille juge au-delà des subtiles haines de caserne : " Mes gars, les galonnés sont comme nous, des esclavages de la République ". Le pépère me sort un quotidien socialiste vieux de huit jours qui prône l’union sacrée et patronne les marchands de canons, ce dont le vieux semble fort marri.
Diversion. De partout convergent sur la chaussée unique des troupes de toutes armes qui se mélangent en un affreux désordre ; débris de régiments dont nous ne soupçonnions pas la présence. Des légions de civils mises en branle par les échos des sévices boches sur leurs congénères belges se jettent dans la coulée. Meubles, matelas, femmes, gosses muets, charrettes craquantes sous le poids déménagent monstrueusement. De temps à autre, le tout est poussé sans pitié au fossé, pour faire place à l’artillerie qui passe pressée. Civils et soldats, pris dans une même fatigue, s’écroulent au talus jurent de crever sur place, repartent pour choir plus loin, puis reprennent leur démente galopade.
Impérieux coups de corne. Des autos exigent le passage, progressent coûte que coûte dans le fleuve humain, bousculant sans vergogne. L’identité de ces automobilistes fonçant ainsi rideaux baissés est rapidement mise à jour de par la présence d’un des officiers pistoléteurs, installé à côté du chauffeur de la première voiture. Le général, ses acolytes et ses gendarmes voudraient filer incognito mais de violentes apostrophes saluent le convoi de faquins dont l’inconséquente légèreté est cause direct de la pétaudière dans laquelle nous nous trouvons.
- La Révolution les fusillerait, beugle un officier sans ouailles qui a son mot pour les civils " cette mijotée d’espions sur notre route ". Haro sur l’état-major. Fusillons. Fusillons ! Haro sur les civils�
Il s’attelle, sabre au clair, à contraindre tout seul cotillons, casquettes, jambettes et carriolettes à progresser vers la forêt d’Argonne qui nous attend à quelque cents mètres. Certains de ces malheureux, obéissants, coupent maladroitement par les champs vers les frondaisons promises tandis que la masse résiste pour finalement envoyer le sabreur prendre un bain de poussière d’où il ressort la paume des mains quasiment pelées. Les autres, là-bas, aimantés par la sombre forêt, sont maintenant aux prises avec des gendarmes à cheval qui leur intiment le rebrousse-chemin à l’aide de gestes peu équivoques. Plus loin, d’autres représentants de la maréchaussée activent d’autres civils à regagner leur sous-bois. Depuis quand sommes-nous à marcher ?
Combien nous comptons-nous sur cette brûlante voie à poussière qui nous emmaillote le visage, les cheveux, la vue, la cervelle, qui craque sous les incisives, qui se plaque en écailles dans la sueur du front et des tempes. Le curieux est que ce nuage blanchâtre dansant, qui s’étire sur une anacondesque longueur, ne serve de mire à l’artillerie allemande qui tiraille sur des coteaux déserts. Notre artillerie aux canassons écumants fonce vers une judicieuse nouvelle position. J’entends au passage : 2800 � des mots mystérieux � Les obus filent pour fabriquer des morts. Puis la batterie exige à nouveau son droit de passage. Elle comprime la colonne qui plie, s’éventre, se recoud, frémit, halète. Des officiers aux montures fourbues piétinent de l’avant. Déshabitués de la marche, ils donnent une piètre idée de leur préparation aux rigueurs infantériesques.
Un capiston, loque mouvante, va, courbé au sol, ses espoirs de trente ans évaporés dans ce soleil : il n’aura pas l’Alsace et la Lorraine. Durillon doit faire une sacrée tronche. Lui qui geignant parce qu’il ne voyait que du soldat a dû maintenant attraper son indigestion de civils. Quand on parle du loup !.. C’est bien Durillon que les caprices d’un heurt me font retrouver blanc Pierrot aux traits figés par les duperies d’une Colombine gourgandinesque et qui a jeté aux orties sa chère sacoche. Les épaules du sergent-major plient sous les poids d’une fillette aux cuisses grêles : il n’est pas le seul parmi les nôtres qui trouvent encore d’ultimes forces pour épargner de malheureuses petites jambes. Sur leur perchoir humain, les gosses pleurnichent, se dandinent, roulent la tête à la cadence du porteur. Les mères, cheveux en bataille, traînent leurs pieds qui se tordent et ne se soutiennent plus. Un effarant soleil bombarde sans trêve la horde qui fuie. Chemises, mouchoirs flottent en couvre-nuque derrière les crânes surchauffés. L’amalgame errant roule maintenant à pleins bords. Marchons ! Marchons ! Au soleil déclinant, un village. Soldats, civils y arrivent comme dans un havre d’eaux calmes au milieu de cette tempête de soleil, de l’hallucinante poudre de la route, des kilomètres sans espoir au bout. Un bac immense où circule une eau fraîche. A genoux, les suppliciés de la soif, repiquent dans l’eau claire tandis que pieds crasseux et postérieurs brûlants de la selle font saucette. Femmes, enfants insoucieux des gestes des troupiers effondrés, mènent le plus extravagant charivari pour obtenir droit à la pompe. La grand ‘route charrie toujours. La nuit tombe. La chaleur s’apaise. Vide et silence enfin ! Corps au sol, bras en croix, nous oublions presque que nous sommes des argiles terrestres. Le colonel, jumelles au nez, scrute le lointain de plus en plus imprécis. Des mains nerveuses agitent des cartes où dix paires d’yeux cherchent à identifier le pays haut que de gros obus commencent à marteler.
Chaque nouvelle bordée rapprochant son éventail de suie. Il nous faut évacuer la position. Du reste, le colon prétend avoir des ordres. Flanqué de ses gardes de corps mal rasés, il s’efface de notre présence au trot de sa jument " Estacade ". Nuit close, nous atteignons la forêt d’Argonne. Ici des brancardiers trimbalent des blessés sans savoir où ni a qui les confier. Par des chemins sombres, la compagnie se déroule en chapelet, gagne une cour de ferme où sabote du bétail qui semble attendre l’ordre de fuir. Accaparement total des corps de bâtiments par des locataires qui se montrent immédiatement du plus hostile à toute nouvelle apparition. Allons voir derrière la ferme s’il y a possibilité de se décambrer les reins. Un tapis de verdure sous les sapins qui filtrent la crudité humaine nous invite.
A nous ce moelleux parterre. Lycorde, le poète de la compagnie, grisé par la majesté des lieux, en oublie sa fatigue, s’enfonce en versifiant dans la pénombre et s’affale dans un trou merdouilleux. D’inertes silhouettes que je prends comme dossiers me refoulent à coups de semelles. C’est à savoir où poser son séant. Aplatissons-nous dans l’herbe humide. Le sommeil ne vient pas. On nous annonce que nous sommes aux avant-postes.
- Tirez sur tout ! Ordonne un cavalier inconnu. Il fait placer des sentinelles et manque d’être victime de sa farouche initiative en cavalcadant cinq minutes plus tard dans le brouillard qui se fortifie à mesure que les heures passent.
- Qui c’est ce mec-là ? S’inquiète mon voisin d’observation. Le sergent Finette accouru du petit poste nous apprend qu’il s’agit du lieutenant de la Malicorne, le fameux maniaque de la sentinelle double :
- L’élément capital, primordial, essentiel, du petit poste est le système de la sentinelle. Une sentinelle est composée de deux hommes. Deux hommes forment une sentinelle�Que de fois en caserne de la Malicorne nous a-t-il imprégnés de la formule qu’il finit par nous faire apprendre par cœur. Vite ! La section s’étire en colonne d’escouades. Pentes abruptes de nouveau. Les dos roulent dans le noir qui nous cogne partout. Senteurs de sous-bois, de cuirs surchauffés, de sueur naissante. Des pieds ferrés écharpent des mains candides. Plaintes dans le troupeau surmené. Nuit veloutée. Nuit parfumée. Nuit, Nuit �
Pendant combien d’heures allons-nous ainsi broyant la feuille sèche, raclant l’exubérance végétale qui freine notre course-section Sud - seul conseil donné ! Je fonce au hasard des sentes, tombe sur des isolés cassés à terre, vidant leurs intestins à vif. A peine les ai-je dépassés que j’entends derrière moi leur souffle court. Les patrouilles allemandes nous talonnent. Le silence nous enveloppe, ajoute à notre crainte. Je fonce toujours. J’en trouve qui ronflent, ventre au ciel, surpris par l’irrésistible sommeil au cours d’un bref instant de repos ou d’une chute plus appuyée que les autres. Je les secoue difficilement au passage. Trois fois, je suis tombé moi aussi depuis ce matin. Quelle lutte pour relancer le corps qui flanche ! Quelle sieste je ferais moi aussi ! Mais il faut marcher, carcasse ! Et jeter du lest : veste, équipement, paquets de cartouches que j’enfouis naïvement sous feuilles craquante ou mousse verte. Un copain arrive à ma hauteur, le chef couvert d’un chapeau de paille, tel un Nemrod revenant de taquiner la garenne. Ce débraillé, frappé d’une subite déraison, disparaît sous une pinède aux accents de :
- " Ah si tu voyais ton enfant, ma mère � en train de faire ses trois ans ! "
Deux civils endimanchés, paquets menus en équilibre sur l'épaule, vont quelque temps de concert avec moi. Le premier de ces fuyards à bottines parle de ses terres, l’autre de son eau-de-vie qu’il aurait enfouie derrière sa hutte avant de quitter le village de ses ancêtres. Cours technique sur la confection de la liqueur remontante. Moi je la fais comme ceci ! Et moi comme ça ! Les belles dames par-ci, les beaux messieurs par là. Deux flacons passent d’une bouche à une autre. Claquement de langue. Congratulations.
Je vogue seul maintenant dans la magnificence des fûts centenaires. Je roule doucement sur un talus herbeux. Accordons-nous trente secondes � une minute� deux minutes. Ah, comme je suis bien ! ... Bourrade sur le ventre. Bondissement de tout l’être. Mes yeux s’ouvrent sur des reflets de sabre � prolongé par un officier de hussards, flanqué de quelques cavaliers poussiéreux. Pas le moment de dormir, l’homme ! Grouillez ! Les Boches sont à trois cents mètres.
Poussons une pointe prudente jusqu’à la limite des végétaux frisant la plaine. Là-bas la route est nette de tout trafic militaire, mais dans les champs des groupuscules de uhlans nous devancent de cinq à six cent mètres brandissant leurs lances en des gestes précis qui ne peuvent être que des signaux. Deux de ces lanciers au casque plat ayant la malencontreuse idée de se rabattre vers la forêt, un chœur de mousqueterie les cloue sur place pour l’éternité. De temps à autre je pointe le nez à l’orée des taillis pour voir s’écraser sur la glèbe, dans une discontinuité obsédante, des obus de toutes envergures. Taches jaunes, éventails bleuâtres, crèvent, fusent, s’épanouissent dans le ciel d’un patelin accoté à un contrefort lointain doré par un soleil tenace. Quelle est donc cette cité qui mérite aussi fastueuse canonnade ? En bordure d’une route, seulette, une bâtisse légère m’offre la richesse inattendue d’un ravitaillement précipitamment abandonné. Un coin rustique, tranquille, à peine ridé par le roulement étouffé du canon loin de l’autre côté des voûtes vertes. Au moment de succomber à la plus douce des tentations : galopade débridée, cavalier au visage convulsé. Mon estomac se serre.
- Le troisième bataillon ? S’enquiert l’équestre d’une voix semi-audible. Geste vague de ma part. La monture tend le col vers l’inconnu, tambourinant la terre sèche de ses sabots sonores. Honni soit ce trouble-fête qui vient de réveiller ma fringale de fuite. Je me lance à mon tour de toute la vitesse de mes chevilles vers des dos qui tanguent. Cap sur un trou de lumière.
Clairière. Masure aux murs soutenus par des poiriers, prestement soulagés de leur production. Effroi muet d’une Baucis et d’un Philémon estomaqué tant par l’audace des chapardeurs que par la brutale disparition de ceux-ci. Hasard ! Je débouche sur ma section embusquée derrière un buisson commandant la plaine. Un immense champ visuel nous révèle, à portée de fusil, la progression circonspecte de uhlans foulant la route. Derrière, à deux mille mètres, sous les vergers clairsemés, rampent les longs rubans grisâtres de l’infanterie allemande qu’agacent quelques maigres coups de soixante-quinze. Sans quitter de sa jumelle l’horizon perfide, Finette subit maintenant le vieux aux poires subitement survenu, ses exploits de Crimée plein les lèvres jusqu’à l’instant où la trogne bouleversée de la vieille crève le rideau de feuillage pour nous signaler une agitation insolite du côté de son jardin.
- Ce sont les Prussiens. Sauvez-vous mes gars ! Branle-bas général. Concert de malédictions. Finette se débat, sermonne, gueule, fait barre à la panique.
- Quatre hommes à moi, tonnerre. Quatre hommes ! ... Le sergent désigne aussitôt une " classe treize " comme éclaireur.
- Si c’est les Boches, quoi qu’faut faire sergent ? balbutie-t-il, vert de peur.
- Allez, allez toujours ! Et de pousser l’homme comme un condamné à la bascule. Courte incursion. Minutes longues d’un siècle. Soulagement. Un déboulé de sangliers a été cause de méprise. Demi-tour vers notre base. Deux cent mètres plus bas, nous rejoignons le giron de la compagnie, s’abritant de la rissolade solaire sous des pommiers. Visages poudreux, creusés, poilus : un mois de vie nomade déjà�Des pieds en compote gonflent dans des savates réquisitionnées ici et là dans les maisons rencontrées. Bara, rivé à son tambour, le dos à un arbre, a l’air d’un Christ mal peigné.
- Vivement la guerre, qu’on se tue ! beuglait chaque jour ce compagnon, aux heures mélancoliques de la caserne. Sa tête barbue dodeline ses yeux roulent comme ceux d’un forçat innocent. Pourquoi n’arrête-t-il pas de tripoter son révolver ? Deux pas plus loin, menton aux genoux, l’œil torve, le fourrier Sucre-Sacre présente une silhouette de vaincu moral. Avachissement intégral de ce fringant disciple de Déroulède, son grand homme de la " Revanche ". Au champ de manœuvres, le sportif Sucre-Sacre était pourtant à la fête dans les simili- assauts à la baïonnette, seule arme, à son avis, digne du champ de bataille. Au cours de l’assaut d’avant-hier, point de fourrier ! Disparu, volatilisé. Aujourd’hui, il se pelotonne comme une vieille chatte aux caresses de Phoebus. Pauvres trublions de la gueule ! J’entends encore leur Déroulède pérorant au Plateau de Champigny où m’avait conduit le caprice d’une promenade cycliste. Autour du baveux national, vrombissant d’agressives paroles, une assemblée de Paillasse lâchait des hurlements de fauves en stupre. A l’appel du grand-homme :
- - Nous irons à Berlin ! Un courageux à l’œil cyclope échotait aussi hardiment que puissamment :
- Allons-y tout de suite ! ... Mais assez pensé ! Il faut repartir�Contorsions de culs lourds, d’échines raides. Enlevage maladroit de chameaux flageolant sous le bât. Enfants de la Patrie, raffermissez vos guibolles. C’est pour la France. Trois des enfants sont finis.� Ils pleurent� Trouille d’être faits prisonniers ? Le tambour Bara reste obstinément vissé à son socle de peau d’Ane.
- Ohé, la Babarre, on démarre ! ... En réponse, le revolver de Bara brille à la hauteur de sa tempe, claque� Il a mis un terme à ses souffrances.
- Vivement la guerre, qu’on se tue ! ...Traversée de futaies� Découvertes d’instruments de musique abandonnés par des brancardiers lassés de cette encombrante cargaison fabricatrice d’un héroïsme généreux. Une dizaine de cuivres couchent l’herbe haute - du trombone pansu, au piston belliqueux. Tout ce fourbi de parade gît tordu, éclaté à coup de godillots, de crainte que l’Allemagne en profite. Un des destructeurs y est allé de si bon cœur qu’un talon de chaussure reste incrusté aux flancs d’un saxophone. Durillon, militaire professionnel, approuve cette radicale destruction mais n’en est pas moins surpris devant cet abandon du matériel de l’armée. Il reste là, dans un presque garde -à-vous, méditant sans doute des choses formidables.� Le pas des derniers marcheurs courbés sur leur fusil ou sur quelque bâton, incite enfin le sergent-major à reprendre son allure de canard pressé. Débouchent des brancardiers précédés d’un officier qui porte, tel un crucifix, le drapeau du régiment noir et long dans sa housse vernie. Perdue désemparée cette garde d’honneur cherche en vain une escorte pour la housse et son contenu. D’ailleurs, que font ces gens et leur drapeau ? N’avaient-ils pas ce matin deux heures d’avance à l’extrême-arrière. Mais Roupette, le juteux de la 12�, décide, en se pointant brutalement, aide et protection à la hampe vernissée.
- Demi-tour ! En tirailleurs, couchez-vous ! Hausse 400 ! Ventres plats, respirations cadencées � En charnière de deux sections de fortune, roupette sourd aux objurgations de Finette, reste seul debout, piqueté sur la plaine, l’œil masqué derrière un arbuste-manche à balai. Comment faire comprendre à ce pitre le danger qu’il y a à exhiber sa ventripotence aux jumelles des uhlans probablement très intéressés par nos ébats. �a y est ! Roupette s’est fait repérer. Visite d’obus percutant dans les pâturages anémiés. Jolicoeur glaviotte sa haine à la ronde, maudit sa mère de ne pas l’avoir fait femme. La ville inconnue continue à subir l’arrosage des boulets rouges. Des flammes s’en échappent, ensanglantant le ciel qui s’obscurcit de minute en minute à cause de la fumée intense issue du brasier et qui vient nous faire toussoter. Plus qu’à se retirer. Rien à faire ici. Roupette, d’ailleurs, son drapeau tiré d'affaires, n’y voit pas d’inconvénient. Dans le vallon qui nous cerne, une ferme se présente telle une barricade de pierraille. Des troupes disposées en carapace observent notre lente avancée de pèlerins sur le chemin du Purgatoire.
C’est le 2� Bataillon.
Les collègues nous jettent amèrement qu’ils ont mission de résister et de faciliter la retraite des traînards. Pas le temps de leur présenter des condoléances. Pour nous : atteindre rapidement l’échine de terre qui se hérisse là-bas de mille sapins noirs ! Quinze cents mètres hallucinants �
Le pied de la butte. Un raidillon à 60%. Jouant des genoux, des mains, des dents, de la baïonnette, les hommes s’accrochent, restent en équilibre, hurlent leur crainte de dégringoler, enlacent les arbres, s’arrachent peau et chair. Echelonnement de bras, de fusils tendus, sauts de chamois, gueulantes de toutes espèces, rires !
- Oh ! Hisse ! C’est Durillon qu’on grimpe comme un coffre-fort. Il en perd ses culottes, pète, jure comme un de la Bérézina. Sommet atteint � Dernière vision de la ferme ensevelissant nos camarades sacrifiés à notre salut. Mâchoires serrées, la tête vide, nous plongeons sur le versant Sud dans un carambolage inouï. Un passage à niveau nous regroupe au flanc de son bras de métal. Moisson de pommes. Pose-culotte en ligne de bataille.
- La dysenterie et la fatigue, ça marche pas ensemble, déclare sentencieusement un ex-colonial� Il s’agit pour l’instant de recoller ce débris de compagnie que nous apercevons dans cette enclave de prairie. Je me traîne avec Bidel et quelques autres, mi-vertical, mi à quatre pattes. Bidel s’avoue honteux à la pensée que sa femme pourrait le voir dans cette posture de quadrupède.
Où ce que t ’as vu ça, toué ? Des gars comme nous marcher quasiment comme ma vache, c’est t’i pas honteux quoué ? Il pousse des éclats de rire fou qui laissent présager une fin prochaine tandis que de ses larges mains de paysan il agrippe farouchement la glèbe, par hérédité ancestrale. Voilà le noyau de la compagnie. Une charretée de gros obus aux panaches arc-en-ciel triture la pyramide que nous venons de quitter. Des grappes de retardataires roulent résolument sur la dangereuse pente piaillant comme grives martyrisées. Au nord de la butte, du côté de la ferme, un combat furieux éclate. Crépitement hoqueteux des fusils, tique-taque insistant des mitrailleuses dont les balles viennent siffler jusqu’ici. Quarante minutes durant dans notre bas-fond amplificateur, nous écoutons fesses aux talons les échos de ces échanges culturels tandis qu’à nos pieds de vivants ruisselets chantent dans une nappe de verdure.
Nuit. Pelouse d’une espèce de château.
- Halte ! Faites passer, nom de Dieu ! Silence ! Humus ? Les pieds s’enfoncent. Doux, très doux. Odeur. Le purin nous tient à mi-jambe. Ordre de ne pas bouger. A trois pas, une famille de canards se trémousse inquiète. En auront-ils bientôt fini, les gradés, de palabrer dans le château aux cent fenêtres sinistres ? Echos tragiques : pas de cartes de cette région� La marche à rebours n’avait pas été prévue. Appel à notre confiance ! C’est la voix de Cambuson.
- Mes amis, nous sommes peut-être cernés. Je n’en sais rien. Fiez-vous à moi. Je ferai tout mon possible � Si certains croient mieux faire, je les laisse libres � Le chacun pour soi, Dieu pour tous.
Diversion. A mes côtés, patouillant dans la purinade, je retrouve Larbin, mon compagnon de chambrée, en vadrouille depuis déjà quelques jours, un Larbin bardé de bonne humeur, plus soucieux de rapines et de liberté que du goût des combats perçus de loin. J’ouïs son étonnante équipée. Après le " coup de Belgique ", avec quelques autres, il s’est replié sur Verdun. Expulsé par les gendarmes, il a roulé d’un corps à l’autre, par monts et par vaux, de flux en reflux. Il rapporte d’incroyables tuyaux. " � Marche de l’Allemand sur Paris � Déroute de Lorraine ! � Turpinite qui laisse morts debout des régiments ennemis entiers � Russes entrant à Berlin � Services de l’arrière perdus de vinasse � Généraux fusillés à la grosse � Allemands faisant violer les femmes par les chevaux� Sénégalais mangeant les oreilles à la vinaigrette. " Sacré Larbin. Ce n’est pas le militaire sans défauts, mais quel entrain ! Nous sommes tout ravigotés d’écouter son bagout.
Il me bourre de victuailles inespérées, tandis que nos gradés sont plongés dans une messe basse. Susurrement d’ordres :
- Bidons et baïonnettes bloqués ! Pas de bruit. Qui fume sera occis sur place ! La colonne s’élance vers l’inconnu. Tâchons de ne pas lâcher le pan de la capote qui nous précède. Il y va du salut du monôme, continuellement menacé de dislocation dans ce cheminement derrière un guide civil qui ne s’y reconnaît pas lui-même. Contagion de bûches � L’attelage se détraque. Des mains battent la nuit pour raccrocher le premier fessier sauveteur qui se présente. Jurements en sourdine étouffés heureusement par le lugubre cliquaillis des triques à feu dont certains sont si près de nous que leur flamme nous roussirait presque.
- Français ? Allemands ?
- Silence !
Ferme à la panse grise, sans vie, Altkoch prétend qu’il a repéré d’alternatives lueurs étranges et parle d’y flanquer le feu. Comme il voit des espions partout, personne ne prête attention aux dires de l’ex-légionnaire alsacien. Nouvelle heure de fol exercice par sente de chèvres. Les semelles volent à rase-mottes. Un galop final nous amène à une route qui grince de roulements suspects.
Tout le monde à plat dans l’ombre complice. Le tonnerre de carriole se rapproche. Pourrons-nous tirer dans l’enchevêtrement qui nous entrave ?
Hélé par le qui-vive réglementaire, un attelage français en perdition se démasque. L’homme de brides qui vient d’essuyer des coups de feu à trois cents mètres est momifié d’indécision.
Nous avançons entre des murailles mornes. L’une d’elles est surmontée d’un timide fanion Croix-Rouge. Au passage, bouffées d’iodoformes, plaintes des blessés. Vagues torches ou bougies vacillantes signalent l‘affairisme de cet antre de souffrances.
Les patrouilles lancées en avant tiraillent à tout hasard, se cognent à des flammes roses. On entend des crépitements épars appuyés de hurlements fous de chiens qui ne comprennent pas.
Un ravin sous-bois happe notre cavalcade errante. Une troupe s’y trouve déjà. Injures de part et d’autre. Des voix de plus en plus fortes et nombreuses indiquent la densité des chairs.
Un capitaine que nous reconnaissons à son dégorgé notoire gueule pour nous imposer le silence.
- Tas de salauds. Allez-vous la fermer, crapulards de cosaques ! Vous allez nous faire surprendre. Le premier qui l’ouvre encore, je lui brûle la trogne �
Il aurait du mal à repérer les fautifs dans ce four où l’on ne distingue rien à dix centimètres. Seule une frange lumineuse caresse la ligne où s’étreignent les plus hautes branches. Mais le capiston continue de vider son stock de malédictions. Cette voix de caserne, croassant dans la nuit, nous l’étranglerions avec délices. Un anonyme " ta gueule " met un terme aux élucubrations de ce forcené.
Fusil à pleine poigne, baïonnette haute, nous glissons maintenant sous un incendiaire clair de lune qui arrache mille scintillements à nos armes, étalant sur le talus nos silhouettes géantes. Vainement, je cherche Larbin parmi les capotes qui se trémoussent. Plus de Larbin. Il n’a pas voulu lier son sort au nôtre, je suppose, et a fait sienne la proposition de Cambuson " fuite individuelle " car peu sûr de lui paraît le lieutenant à la tête de notre marche à bon port. Un " qui-vive ? " nous fige au sol. Secondes de lourd silence. Durillon et Cambuson gesticulent au milieu de la route, sans oser pousser plus avant, tant la voix inconnue sonne agressive. Attente � Les douze coups de minuit tombent d’une horloge dans le secteur. Nous n’avons pas le mot de passe Merde ! Ces cons nous prennent pour des Boches ! Sommes des Français, nom de dieu � Réponse : un précautionneux ferraillage de culasse mobile.
- Ils sont capables de nous tirer dessus, ces salauds ! Gémit le lieutenant diarrhéique. Quelques Alsaciens voudraient s’enquérir en langue allemande. Catastrophe ! Heureusement, une voix bien française nous somme d’entonner comme épreuve décisive des �couplets de garnison. Sur le champ, d’un tronc émergeant du sol, échappe en phono couinard un panachage de " Tonkiki, de Tonkinoise " sur les bords du " Missouri ou les mimosas sont fleuris ". A son tour, le sergent-major se lance dans un " Temps des Cerises " à nous faire gratter l’occiput du côté de la bosse à musique, d’une voix de mêlécasse que nous n’avions jamais eu l’honneur d’ouïr. L’homme étalé à ma droite sursaute, hoquète jusqu’au couplet final. Je le crois étreint par l’émotion. Je t’en fous. Il est en pleine crise de rigolade.
- Ah ! c’te vache de Durillon, j’ai cru qu’il allait me faire crever.
Le dernier doute levé, nous avançons deux par deux pour sauter, à cinquante mètres de là, dans une tranchée coupant la route. Trois types s’y démènent là où nous pensions trouver une section en bataille.
- �a fait rien les gars, vous l’avez échappé belle � Nous apprenons alors la fixation de l’avant-garde allemande huit cent mètres plus haut sur cette même route. Et nous qui nous plaignions de couper à travers champs ! Rapide traversée du village proche. Pas âme qui vive. Dans une grange aux battants colossaux s’écroulent nos chairs meurtries. Revanche d’un sommeil formidable refoulé par le destin.
Jour. Les coups de feu qui n’ont pas cessé de la nuit se font plus rares. Odeur de crottin. Puanteur de mare. Par la porte baillante, je vois la route déserte. Un silence inquiétant plane sur nos corps confondus dans la paille. Macarre, déjà sur pattes, n’a pas l’air à l’aise. Tiens ! Vrombissement. Auto. Freinage grincheux. Deux officiers d’état-major bondissent à terre. Hurleries qui les étranglent.
- Que faites-vous ici ? Qui est-ce qui commande ? Aux armes, aux armes ! � Cambuson qui sommeille pesantesquement s’ébroue dans la paille. Durillon a sauté sur son sabre Cambuson cherche vainement ses bottes. Se résigne à se suffire de ses seuls étriers. Ankylosé par ce repos prolongé, je ne puis me tenir droit sans de percutantes douleurs. Un abrutissement record nous fige. Nous nous regardons sans bien comprendre encore tandis que l’auto d’alerte file à se rompre les courroies, en bondissements ivres. A peine le temps de se rendre compte que puits et pompe ont été mis hors d’usage que déjà, la horde, en vrac, démarre. Nous apprenons que l’Allemand a repris sa marche, que les garde-tranchées de cette nuit n’étaient que traînards guerroyant pour leur propre compte, que les coups de feu de soi-disant avant-postes émanaient d’autres traînards friands de succès individuels. Cambuson est furieux.
- Cette nuit, nous aurions pu nous rabattre de quatre kilomètres. Alors qu’avec ces salopards de francs-tireurs qui nous ont tiré fourré dedans � Ah, ces francs-tireurs ! Quelle pétaudière ! � Long rectangle de la plaine. Aussi loin que la vue porte, rien à discerner, pas l’ombre d’une vie sinon le léger balancement de la verte chevelure du sol. Plus de rideaux de futaies qui nous ont permis jusqu’à ce jour de narguer l’artillerie adverse. Sur ces champs où court, rectiligne, la route, ce serait folie que de s’offrir aux canons ennemis certainement à l’affût sur les crêtes par nous abandonnées hier. Mais où passer ? Inquiétude dans l’œil de nos bergers. La situation redevient critique. La nature qui fait quelquefois bien les choses a sillonné la prairie d’un fin ruisseau palissadé de saules touffus. Un saut. File indienne. L’eau aux mollets, nous parcourons à l’abri de cette frondaison inespérée les quelques centaines de mètres qui nous séparent d’un plissement de terrain salvateur, amorce d’une route secondaire pointant vers le Sud. Muscles chauffés par ce premier effort, nous retrouvons une certaine assurance de marche sous un soleil lorgnant déjà sa proie de traîne-la-patte.
- Si la fournaise d’hier remet ça, c’est inquiétant ! Gémit Durillon dont le regard rond en direction des hommes exprime l’angoisse d’une poule qui couve. A pleines jambes, dans le matin encore hospitalier, nous avalons du kilomètre. La disette de tabac règne. Les peu fumeurs n’en souffrent guère mais combien de désaxés à leurs côtés par manque de " perlot ". Fraternellement, trois citoyens de Mulhouse machouillent un unique bout de chique baveux à faire vomir un régiment de vidangeurs et qu’ils se repassent cérémonieusement. Subitement, l‘horizon, peu fourni depuis hier en troupes amies, nous révèle là-bas une foule baignée de poussière. Nous activons les enjambées pour nous souder à cette horde fuyant dans le soleil oblique. Déjà nous talonnons son arrière-garde de cavaliers cuirassés d’indifférence à notre égard. L’un de ces ostrogoths, juché sur une pitoyable monture, nous cravache du traditionnel.
- Alors les pousse-cailloux, toujours mal au bide ? Cette fois c’en est trop. Jolicoeur, qui espérait quelque compliment pour être revenu d’assez loin, se fâche tout net :
- Eh, va donc, six pattes � Fesses saignantes. Sabot cornu �Tout le répertoire des grandes manœuvres y passe. Le policier boxeur qui a repris rang parmi nous cherche à placer un mot mais subit à son tour la vivacité verbale de Jolicoeur en veine de vocabulaire. Le mainteneur d’ordre baisse les yeux. Les visages tournent à l’euphorie pendant que Cambuson, imperturbable, vide dans son gosier un litron d’eau de vie prélevé dans la ferme qui hébergea notre sommeil réparateur. Les grondements d’une canonnade peu lointaine deviennent insistants. Un " Aviatik " curieux nous survole à faible altitude. Inutile d’user nos balles sur cet oiseau dont les croix de fer disparaissent d’ailleurs tout aussitôt derrière la colline. Ecrasé ? ... Tant pis, fallait pas qu’il y aille ! Mais où sont les avions français ? Finette soutient qu’il en a vu un !!! Il y a huit jours. Bravo ! Nous remontons des éléments d’une infanterie stupéfaits par notre apparition. Ces confrères de corps d’armée nous signalent le 561�� à plusieurs encablures en amont.
- Allons-y et tant que ça peut ! clame Cambuson devenu soudainement loquace par la conjonction dynamique de l’eau-de-vie et la certitude de retrouver notre mère le régiment.
Jonction. Dans un minuscule champ de luzerne, quatre cents lézards étalés, faces cuisant doucement au soleil mijoteur. Le colonel semble surpris de notre arrivée. Il abandonne la contemplation de son cheval. Aux côtés du vieux, un état-major hétéroclite rumine son amertume. On dirait que ces paradeurs vivent leur dernière minute. Disparus les monocles qui, il y a peu de jours encore, vitraient leur œil mondain.
Seul, celui du colonel, continue de valser au bout de sa laisse sur le petit bedon napoléonien. De la Malicorne, qui gardait certainement le sien en son sommeil pour ne pas perdre un poil de son arrogance, courbe la tête come un pénitent pascal. Le colon qui nous croyait disparus à tout jamais s’éclaire. C’est tout juste si ces deux cents lascars, déjà passé dans son esprit aux profits et pertes du 561�, ne lui paraissent tomber du ciel. Eloquence :
- Ah, mes enfants ! Ah, ah ! Je savais bien� ah, ah ! Heureusement qu’il y a plus de civils aujourd’hui pour nous gêner � Monsieur Cambuson, vos hommes ont-ils bien leurs deux cent cinquante cartouches ? Cambuson ne peut dissimuler son déconfit devant cette interpellation qu’il juge méprisante pour sa tactique.
Fatras de troupes. Formations régulières alternent avec les plus équivoques mélanges. A califourchon sur leurs montures métalliques, un peloton cycliste joue des mollets. La moitié des pneus sont à plat. Tiens ! Mais que fait donc ce civil solitaire au cou fixé par un licol à la queue du cheval d’un gendarme ? L’animal, par saccades, mouline terriblement son appendice poilu. La tête de l’homme se soulève en cadence, roulant des yeux d’agonie. Ce qui entretient le représentant de la force publique dans une douce hilarité au milieu de la gravité générale. Un espion ? Il paraît.
- Les cognes et les sergots � susurre Jolicoeur, l’homme au casque � je leur ch� dans la gueule�
Laborieuse mise en route. La température monte. L’atmosphère nous étouffe de plus en plus. Les choses commencent à bouger dans ce kaléidoscope de bornes, de villages, de côtes, de troupes saupoudrées de poussière blanche. Des uniformes tassés au talus ripaillent ou ronflent sans souci du flot qui passe. D’autres bataillent autour de pompes chargées de chaînes. Dans un patelin pestilentiel, une espèce de grand-Ferré à livrée de dragon émiette d’une hache furieuse le portillon d’un puits cadenassé au milieu d’un hourvari de gosiers assoiffés. Plus loin, un tourbillon de fantassins se rue sur une fromagerie dont les produits sont empilés dans une rustique vitrine qui semble des plus fastueuses. Derrière les volets presque clos, des yeux assistent immobiles à ce pillage. Pourquoi payer le propriétaire dont l’évidente mauvaise volonté à nous vendre donne l’impression que ce salopard réserve ses fromages pour les Prussiens.
- Quand ça coûte rien, c’est meilleur, décrète Tartignol Théodule, fantassin de 1� classe. Cambuson qui nous a rejoint avec son pensionnat d’égarés claironne son dégoût devant les pompes inutilisables.
- Ces gens méritent d’être fusillés �C’est à se croire en pays ennemi � Qui peut prédire des choses pareilles entre Français ?... Ne dramatisons pas, lieutenant, pour quelques bouches d’eau mises sous clef, geste coutumier d’une population saturée des exploits de militaires déprédateurs d’un bout de l’an à l’autre. Nous sommes dans l’Est, terrain de prédilection de la soldatesque. Mais Cambuson n’a cure d’explications. Le voilà qui prend maintenant à partie un vieillard terrifié qu’il menace de son pistolet éléphant modèle 1850.
- Si ces croquants oublient que nous sommes en guerre, je vais le leur apprendre !
- Tout doux, lieutenant, l’ennemi va s’en charger !
A l’entrée d’un gros bourg, un festival de rires nous accueille. Derrière un mur, une douzaine de laveuses, battoirs en arrêt, s’esclaffent au coyonnades oratoires d’un tringlot éméché. Roupette, l’adjudant de la 12� - flairant la vérité, d’un rageur coup de botte au postérieur, expédie le tringlot dans la savonneuse piscine, au milieu des cris pointus des spectatrices éclaboussées jusqu’au scandale. Rougeaud de triomphe, l’adjudant s’esquive vers sa section introuvable dans le grouillement complexe qui déferle. Il revient aussitôt avec des gémissements de chien perdu. Nous fixe. Repart � Par petits paquets, nous cheminons en mauvais ordre raclant le sol de nos chaussures pesantes plus faites pour les labours de novembre que pour les sentes d’amoureux. De maigrichonnes siestes au long de la chaussée calcinée sont censées nous redonner de l’allant. J’en suis réduit à fermer à tout de rôle mes paupières irritées. Lycorde le poète, également atteint de cécité partielle, me vante l’efficacité de l’urine de jument pleine pour la guérison des yeux mal en point. Mais où trouver la jument pleine. ? Partout des pantalons rouges défensivement entassés contre le feu solaire dans l’ombre de rares arbustes. Aucune puissance, ni les hennissements de Roupette, n’empêcheront mon derrière de se poser au pied de ce framboisier qui m’invite.
Carrefour. D’une " départementale " sortent des hommes tellement poussiéreux qu’ils semblent toucher au rivage après avoir traversé une mer de plâtre. Ouvrant la marche, on dirait la silhouette d’un colonel, suivi d’officiers, tous sans montures. Suit � bloc compact � une colonne couvrant toute la voie dans un ordre impressionnant. Deux compagnies paraissent marcher de front. A ce spectacle, Roupette, livide, concentré, bat un ultime rappel.
- Vous voyez bien ! Il n’y a que nous dans la pagaïe : Allons vous n’êtes pas morts ! Faisons comme eux� Montrez que vous êtes des hommes ! ...
- Merde !...
Ce régiment de réserve qui s’est encore peu battu n’a pas bouffé le tiers des kilomètres que nous avons dans l’œsophage depuis une quinzaine de jours. Roupette s’éloigne, hochant la mâchoire.
Torpeur. Je retrouve la verticale pendant que dix mains secouent Durillon lové dans son sommeil. Le sergent-major s’ébranle enfin, hoquetant :
- C’est la retraite de Moscou� c’est la retraite de Moscou, Cet homme de bonne volonté a atteint ses limites.
- Oui, la retraite de Moscou avec 32 à l’ombre ! Ricane Tartignole Théodule qui ne voit dans cette allusion moscovite qu’une déliquescence des méninges de Durillon et le déclare mûr pour Charenton. Nous sommes trois à suivre une ligne de tortillard qui ondule vers une gare que nous trouvons engourdie de solitude. Le dépit de notre trio est accentué par le quatrième clochard qui nous talonne. Pris d’une furieuse déception, il se roule épileptique ment sur le ballast. Plus qu’à rejoindre la route qui dégorge toujours autant. Le fait est sûr. Nous n’allons plus à Paris. Alors pourquoi cette retraite sans fin ne cesse-t-elle pas ?
- Qu’on nous fasse tuer ici !
- Qu’on se batte ici ! Répond l’écho des moins ardents. Tous, tous nous en avons assez de cette despotique promenade qui fond nos corps, nos cerveaux. Tiens, que se passe-t-il dans la prairie ? Une bande de troupiers-nourrissons se rue sur un troupeau de ruminantes aux monstrueuses mamelles.
Certaines mains habiles débitent un lait floconneux dont la seule vue éveille en mon estomac défait la nausée catastrophique. Je reste quand même stupéfait en voyant ces contre-experts en l’art de traire qui, à plat ventre ou sur les genoux, sucent éperdument les pis. Ils vont avaler la vache. Un colonial, d’un coup de fusil, abat un bœuf. Veut-il s’en repaître ? Non. Il s’éloigne satisfait, drapé dans un port héroïque. Les officiers, juchés sur des chevaux ou légèrement équipés, caracolent à l’avant escortés des marcheurs d’élite. Nous ne les rejoignons qu’au stationnement du soir. Quel délice que de divaguer affranchis du " par quatre " si le bruit des bottes germaines ne nous chantait aux arrières. J’en arrive à choir tous les deux out rois cent mètres. Mon corps garde mollement sa position de contact sans que mon cerveau engourdi puisse commander une rectification quelconque. J’en suis à l’une de ces bûches quand, entrouvrant les paupières, j’aperçois un grand bougre de curé barbu, chapeauté démesurément, qui me caresse de son sourire jocondéen.
- Eau de vie ? Alcool de menthe ? En même temps, deux gourdes en poires à lavement me gratouillent la moustache.
Cet homme, qui ne craint pas de s'aventurer à portée des Mauser, se présente avec une jovialité non feinte comme missionnaire attaché à la division. Quel optimisme traîne dans sa jupette à cet avocat du ciel ! Avec quelle émotion j’apprends de sa bouche que la retraite va enfin s’arrêter. Tendant sa main velue vers ce que je prenais pour un mirage :
- Si ! Si ! C’est un village. Six kilomètres tout au plus et vous retrouverez votre régiment. Tenez, passez-moi votre fusil. Appuyez-vous sur mon vélo. Faisons l’Aveugle et le Paralytique �
Chemin faisant, mon compagnon se jette quelques lampées de cette eau bénite nouvelle. Dans l’espace lointain, teinté des couleurs fauves du soir, de longs convois régimentaires, trains de combat, échelons de carrioles de tout acabit s’incurvent vers l’arrière du patelin dont la corpulence me paraît toujours reculer. Des abords enfin, je découvre une extraordinaire animation dans laquelle je me jette en un dernier sursaut de volonté, perdant par la même occasion mon curé et sa bécane. Un tournant cul-de-sac. Face à la Mairie-Ecole, Cambuson ponctue d’un geste sec ou d’une supplique de paysan madré ses :
- Quel régiment ? Quelle compagnie ? Par ici ! Par là ! Allons, un petit effort mes amis ! Le lieutenant agrippe les capotes moites, trie, parlemente, dirige vers des cantonnements sui germent, enflent : voûte de granges, étables à porcs, prairie voisine où pissotte un ruisseau. Travail de bénédictin, d’imperator ou de maîtres Jacques réglant le débit des chandelles. Les autres officiers se prélassent dans la maison commune. Le colonel vérifie son cheval. Le capitaine ronfle sur le bureau de l’instituteur. De la Malicorne, l’homme au monocle, doit prendre un bain de pieds quelque part.
Ma section s’installe dans une forge. Le propriétaire des lieux ne l’entend pas de cette oreille. Sommé de déguerpir depuis le matin, par ordre supérieur, avec sa famille et ses hardes, le vieux furieux de ne pouvoir emporter sa paille qu’il jure être du blé, voudrait nous empêcher d’en faire litière. Arrive le colon, mis au courant. Nous voyons le moment où il va faire fusiller ce vieil imbécile acharné à nous interdire ce que le Boche fera demain. A l’insu des officiers et par douzaines, nous nous plongeons en tenue d’Adam dans le ruisseau tentateur. Et puis, quelle belle occasion de troquer les liquettes ignobles contre du linge frai trouvé dans les armoires dodues abandonnées par l’habitant. Mais Durillon, tel un dogue ressuscité, apparaît vilainement sur la berge époustouflé devant ce qu’il appelle notre audace.
- C’est du joli. C’est du joli ! Son dépit ne connaît plus de bornes quand il aperçoit Jolicoeur et deux copains délicatement attifés de linge féminin. Les yeux du sergent-major vont du sol au ciel, son menton tressaute, de sa bouche édentée sort enfin cette condamnation sans appel :
- Je préfère mourir immédiatement que de risquer de me faire tuer dans un pantalon de femme.
- Le répète pas à ta grand-mère, gouaille une voix humide.
A peine sortis de cette baignoire rustique, ventre tordu de glouglous infernaux, les amateurs de trempette se ruent dans tous les recoins vaincus par les méfaits de l’eau traîtresse.
C’est dans cet état - l’âme accrochée à l’intestin - que je suis désigné, la nuit venue, comme sentinelle à quelque huit cent mètres devant le village. Nous relevons en route la section d‘avant-poste du 1� Bataillon. Encore cent mètres. C’est ici. Echange de consignes. Mot de passe ? Cambronne. Décidément nous n’en sortirons pas, constate finement le sergent Finette. Jusqu’ à deux heures du matin, nous sommes trois hommes à faire alternativement le guet. Un peu en retrait, la section passe ses nocturnes loisirs à se déculotter, à se reculotter. Ce désastre abdominal se calme un peu après notre retour à la forge-dortoir. Quiétude. Mais du côté du Nord, ces immenses lueurs multiformes qui embrasent le ciel nous rappellent que ces feux de St-Jean ne sont pas de saison.
Aurore.
Appel ! Par habitude, il ne manque personne. Jolicoeur achève à peine à glisser que c’est peut-être la fin de la guerre que déjà d’une voix étouffée le lieutenant débite le contenu du papelard qu’il triture dans sa paume.
- Soldats �
Au moment où va se livrer une bataille d’où dépend le sort du pays�
�moment n'est plus de regarder en arrière�
�tous les efforts pour aller de l’avant�
�tenir coûte que coûte�
�se faire tuer sur place plutôt que de reculer�
�aucune défaillance ne sera tolérée�
Cambuson commente :
- " Nous allons nous porter à quelques kilomètres en arrière, au village de Châti-Loupiots� Vous êtes fatigués� Moi aussi. Tâchons de rester groupés. Là-bas, plus un pouce de terrain à perdre. Nous serrerons les mâchoires. D’ailleurs, tous les obus ne tuent pas. Vive la France ! ".� Les épaules des prévenus rentrent au choc des sentences massives. Un " merde " étranglé sort du faciès tourmenté de mon voisin. Seule la charpente ivrogniforme de l’idiot du village -toujours là au bon moment celui-là - est agitée de joyeux trémoussis.
Bourrage de cartouches. Café dans la panse, nous nous ébranlons, surpris de croiser quelques carrioles de fugitifs qui, désorientés, se dirigent en plein sur l’ennemi. Au pied d’une pente raide, la ruelle d’un bourg a recueilli un convoi de fuyards paralysés par les balles d’une mitrailleuse allemande qui jacasse sur la colline. Ici encore, pompes et puis sont soigneusement cadenassés mais, cette fois, par ordre de la " brigade " : le général craint de voir ses bataillons se dissocier à l’appel de l’eau. Au diable la pépie du soldat ! Marquillon et son état-major ont leur caisson-cave bien achalandé ! Il suffit de regarder Double-mètre, le colon artilleur, en perdition sur la chaussée, mélangeant ses compas bottés. Plein comme une outre, il se soulage tous les cent mètres.
Abandonnant la route, les trois bataillons évoluent par fonds et pentes, tournoyant, repassant dix fois aux mêmes endroits. La graine de traînards s’éparpille à nouveau sur le terrain sans que le colonel paraisse s’en inquiéter. Le voici maintenant qui nous presse au cœur d’un pénible marécage dont l’eau nous suce les jambes : en avant quand même ! Mais le régiment reste pris sans pouvoir s’arracher à cette glue infâme. Conseil de guerre dans la mélasse. Le colon s’obstine� quand enfin le capitaine comprenant la situation se prend à brailler.
- Il faut reculer ! On ne peut pas rester là ! C’est insensé une manœuvre pareille ! ... Nous refaisons surface dans un carré de betteraves potagèrement annexé à un cimetière. Quelques douzaines de retardés gigotent encore dans le bourbier canaille. Je ne dois moi-même qu’à l’aide précieuse de l’Alsacien Pillet, blond gaillard à jeune frimousse, de pouvoir avaler l’ultime kilomètre borné par la nécropole d’où nous repérons les avancées d’un petit patelin enfoui dans la mousse " Chati-Loupiots " sur la plaque indicatrice. C’est ici qu’on va en découdre ! Rapidement le patelin se purge avec notre arrivée. Dragons aux lances burlesques, derniers caissons et guimbardes détalent pour nous laisser le mouvement libre.
Egrené dans la verdure, le régiment ne se présente plus maintenant qu’en deux minces lignes de tirailleurs, face au nord, le regard farfouillant les ruelles mortes, bordées de masures que garde un clocher campagnard. Profilant dans les trouées du feuillage son armature de métal, un pont offre l’hospitalité à la dernière de nos mitrailleuses. Quelques pigeons banquètent en ligne devant une tablée de crottin, cadeau de la cavalerie galopeusement repliée. Sur nos arrières, la plaine s’étend monotonément vide. Il ne faudra pas compter sur le soutien. Ecarquillons bien les mirettes !...
A part un petit groupe de brancardier, défilés derrière un talus présidé par le major Popoille, saoul comme une grive, pas une âme qui vive. Les jumelles de Cambuson dissèquent le village où une vague agitation semble se manifester. Des agents de liaison collectent des ordres définitifs que nous captons, à plat ventre, l’œil collé à la hausse, prêts à la tuerie collective.
8 heures !
Brusquement, inattendue comme tornade dans défilé de montagne, de gauche accourt canonnade féroce. Cratères ouvrent tous côté. Terre fétide saute au visage.
Orgueilleuses pierrailles cimetière affaissent en vrac. Vanité repos éternel !
Sol bouge partout. Fusillade ondule plus en plus puissante. Immense crucifix champs morts contemple, impavide, cette colère.
Colonel, juché sur " Esclarmonde ", jaillit du fourré.
Sabre au poing, le Vieux gueule dans tumulte :
Les enfants, c’est pour� Obus fauche homme monture.
Attention ! hurle le sergent-major Durillon.
Hausse 400� A mon commandement�
" Ici finit la geste que Fantold� declinet� "
|