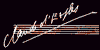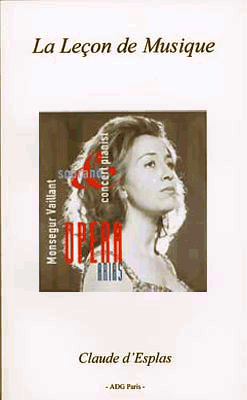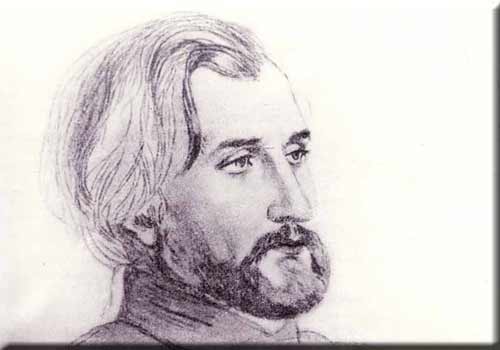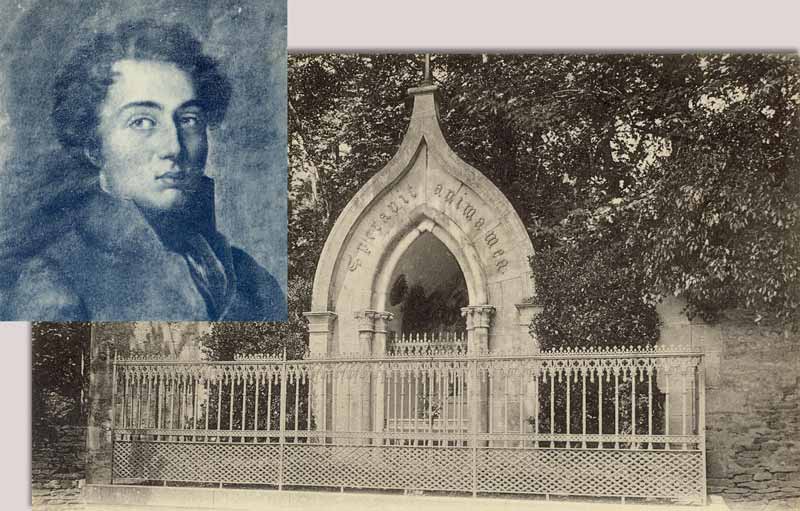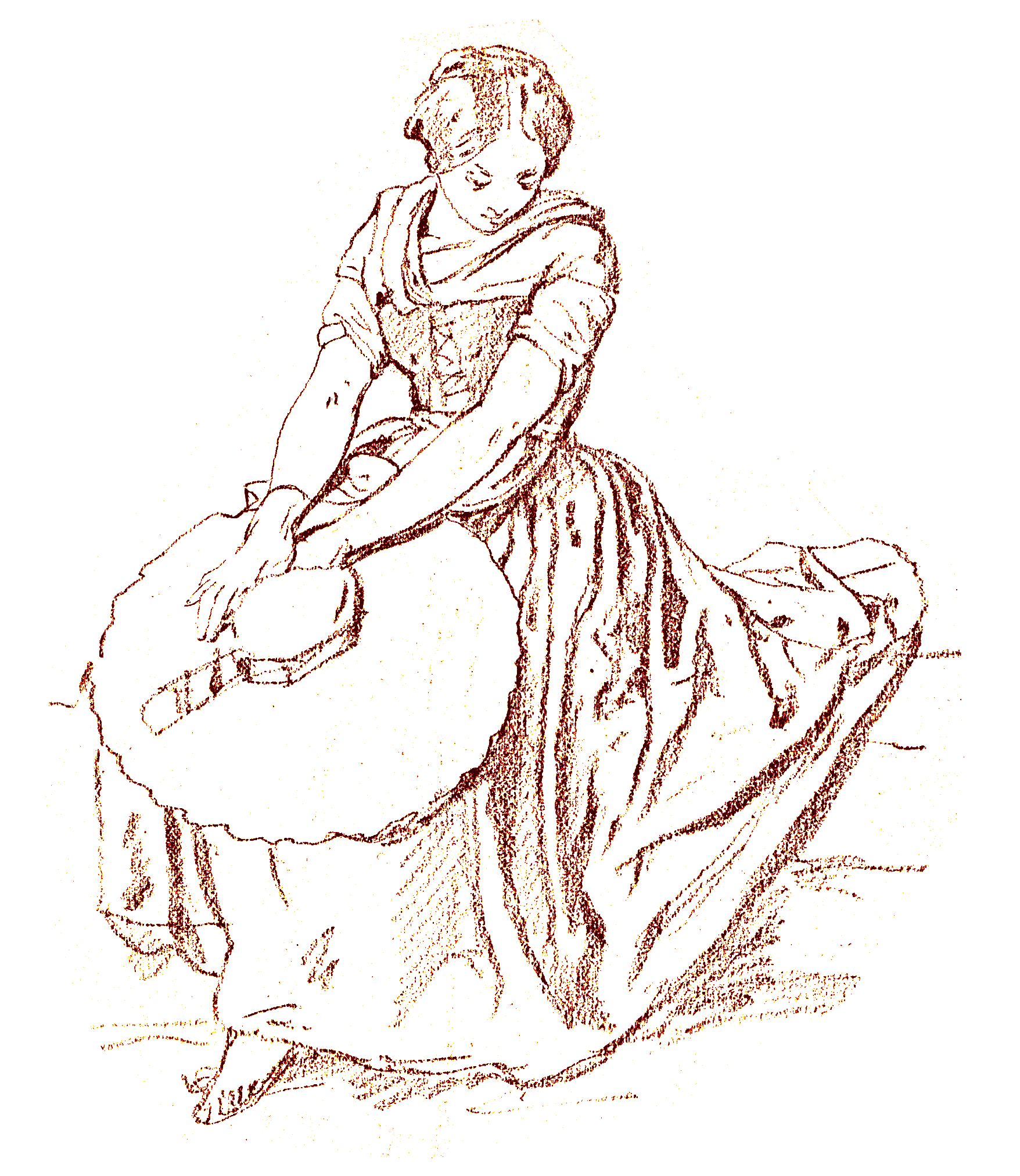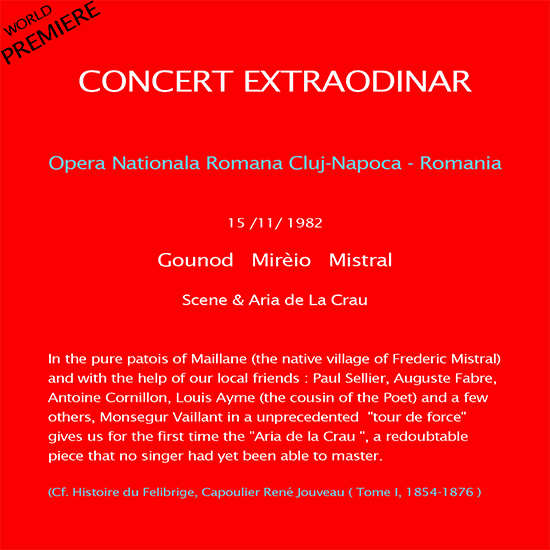|
|

Les jugements d’Ivan Tourgueniev, tout au long de sa correspondance, sont d’une ironie mordante et cruelle en matière musicale�: mais il revient parfois sur ses affirmations comme il le dit si bien lui-même�: "En général je vois que j’ai (par rapport à Melle� Lind) selon ma louable coutume commencé� par aller trop à droite, puis je me suis jeté trop à gauche � elle est une cantatrice charmante, faisant certaines choses mieux que personne mais..� mais� � mais elle n’est pas tragédienne, mais elle joue un peu à l’allemande, mais je connais une certaine personne avec (sic)� laquelle je l’ai comparée un peu à l’étourdi, etc�etc�" ou encore "Hier je suis allé voir Melle� Patti dans l’Elisir. Elle est fort gentille, sa voix est charmante, d’une justesse d’intonation et d’une pureté parfaite, mais ce n’est pas une cantatrice, et ce n’est surtout pas une actrice � le public en raffole" (37 rappels pour�Mireille�à St Pétersbourg)"et elle a l’air de s’amuser comme une reine".� Aussi bien en 1846-47 qu’en 1864, Tourgueniev sait exercer, quand il le veut, son sens critique tant sur le plan vocal que scénique. "Parlons un peu de�Robert le Diable�qu’on nous a donné avant-hier, je vous le dis en vérité�: les représentations de Berlin étaient à cent mille� piques au-dessus de celles de Londres. Fraschini est monstrueux, hideux, horrible dans le rôle de Robert�; sa voix criarde, strangulée, agace les nerfs�; et puis il avait l’air d’un lièvre qui se donne au diable, complètement démoralisé. Staudigel a perdu sa voix, Mme Castellan s’est tout à fait gâté la sienne en voulant se donner des notes de poitrine".
Il y a là quelques appréciations fort intéressantes en matière de technique vocale qui ne s’expliquent que par un instinct du chant, affiné par les contacts permanents avec la Famille Viardot et aussi Manuel Garcia�: (auteur de l’Ecole de Garcia, traité complet de l’Art du Chant) en compagnie duquel il assistera à une représentation du�Faust�de Gounod le 15 Septembre 1859. D’autres réflexions nous renseignent sur les habitudes du temps qui permettaient aux cantatrices d’introduire des airs autres que ceux de la partition (dansRomeo e Giulietta�de Zingarelli, la Malibran place un air de Mercadante au lieu de l’air de Sigismond choisi par La Pasta), soit des traits à l’intérieur des airs�: "Dans le�Quando lascia�la Normandie", elle (Melle Lind) fait un trait délicieux�; si c’est elle qui l’a trouvé, je l’en félicite. Que ne suis-je musicien pour vous le noter?". Tourgueniev est sensible non seulement à la mise en scène traditionnelle (il le prouve en blâmant celle de�Don Juan�à St Pétersbourg et surtout en détaillant celle de�Mireille�sur laquelle il s’étend en accordant une place des plus limitées aux chanteurs) comme il perçoit et cherche à expliquer à sa correspondante la mise en scène� dite vocale. "J’aurai bien voulu que vous, Madame, l’eussiez vue (Melle Lind dans la�Somnanbule�ou�Robert�(�).
Est-ce l’amitié passionnée qu’éprouve l’auteur de ces lettres pour la personne de Pauline Viardot, est-ce l’intérêt qu’il porte à ses rôles qui peuvent expliquer son attitude lors des représentations de�Faust� à Paris (dont il laisse donner le commentaire à Pauline Viardot par son frère Manuel), ou celles de�Mireille�dont il décrit âprement la mise en scène et apprécie la musique des deux premiers actes, "ces deux diamants", selon le critique musical anglais Chorley, mais que l’héroïne ne semble pas émouvoir puisque l’on glane au passage des phrases telles que "Melle Carvalho chante à ravir".� Il ne s’agit pas ici, comme pour�Sapho, d’un rôle conçu pour la voix de Pauline Viardot, voix qui va s’épanouissant vers le grave, constate Tourgueniev�: "Je suis content que vous ne chantiez pas�Otello", lui dit-il, "il vous faut maintenant des choses plus larges et plus grandes mais d’une tessiture plus élevée dans le phrasé" de la mélodie française que Gounod et Fauré porteront au niveau d’expression que l’on sait, ce modelé de colorature aux inflexions parfois tragiques que la flexibilité de la voix de Maria Malibran aurait, peut-être, pu atteindre, les circonstances aidant.
Tourgueniev se tait pour�Faust�et aussi pour�Mireille�bien qu’ayant été mêlé intimement à la création du personnage vocal de Sapho�; puis brusquement nous assistons à une mise à mort sans banderilles préalables dans son commentaire de la représentation deRoméo et Juliette�le mardi 18 juin 1867. "L’exécution est détestable � jamais, au grand jamais on a braillé, hurlé, dégueulé, glapi comme cela. Tous chantent faux en diable� et Mme Miolan � sous prétexte de faire la passionnée, hurle et crie comme les autres avec une voix éraillée, chaudronneuse, thérésiéforme�!" Cf�: Thérésa, pseudonyme pour Emma Valadon, cantatrice de Café concert. En trois ans Mme Miolan aurait-elle démérité à ce point, elle qui en 1875, sera la première Marguerite du�Faust�de Gounod au Palais Garnier�? N’y a-t-il pas eu plutôt cristallisation d’un agacement porté jusqu’à l’exaspération par la troisième partition de Gounod où nous retrouvons, plus souligné que jamais, cet écho de lyrisme religieux que le poète russe supporte mal�?�
Tourgueniev signale avec ironie que Melle Mireille meurt d’un coup de soleil en chantant un chant d’extase qui n’est que "du Halévy de 4ème ordre". Cet Halévy-là serait-il de moins belle eau que le premier opéra du jeune compositeur français de retour de Rome, que Maria Garcia défendra si hardiment qu’elle obtint un succès fou dans�Clari, et prêta à ce rôle toute la magie de son expression�? Cornélie Falcon et Adolphe Nourrit furent les créateurs des�Huguenots�de Meyerbeer. Pauline Viardot écrit, "l’Opéra compte sur�Les�Huguenots,�Le Prophète�et�Sapho�pour faire les frais de mon hiver" et nous relevons la référence suivante dans une lettre de Tourgueniev (à propos des dernières représentations du�Prophète), "Mr Jules Janin vous nomme deux fois de la façon suivante�: "Imaginez vous au paradis entre deux enfers, Rose Chéri entre deux duègnes, la Viardot entre deux ténors de province". Si Tourgueniev avance qu’il n’y a pas de mauvaise exécution qui puisse tuer un chef d’œuvre, coupures et transformations peuvent défigurer un opéra, original par son histoire et son climat provençal, une œuvre exigeant�une�voix totale et non pas la voix, "perlée" soit-elle , de Mme Miolan-Carvalho (en les propres termes de Mistral qui pensait bien sûr à ce "brillant" qu’avait exigé la chanteuse forte de l’appui de son Directeur de mari). (Cf�: Sounet a Dono Miolan-Carvalho.�Lis Isclo d’Or)... Mistral devait rapidement changer d’avis.
Il se peut, dit notre Ivan le Terrible, que le talent s’adresse aux�dilettanti, aux gens de goût� � et cela vous fait désirer presque de ne pas en être � � la nature vraie est bien autrement chaude, elle est plus opaque, plus vulgaire, si vous voulez. Et puis, il n’y a pas cette verve scénique, cette hardiesse, ce laisser-aller qui caractérise l’artiste. Il ne semble pas que Gounod ait été satisfait, de son vivant, des�tempi�orchestraux et de la distribution des premiers rôles féminins. C’est "affaiblie, dénaturée" que�Mireille�fut présentée au public le 19 mars 1864. Dans la�scène de la Crau, "redoutable encore quoique mutilée", Mme Carvalho prise de peur, "échoua complètement". "On ne fit pas seulement grief à la cantatrice d’avoir contraint Gounod à retirer le joyau de sa partition mais d’avoir refusé de porter, au moins pour les premières représentations, "un costume provençal authentique", bien qu’elle ait reçu du peintre Bonaventure Laurens, "une collection de dessins de costumes d’arlésiennes" (et de comtadines). Ce que nous savons, par Tourgueniev, du talent dramatique d’Adelina Patti, ne nous engage pas à croire qu’elle ait pu bouleverser le 28 novembre 1888 le public du Palais Garnier, lors de la 1ère représentation de Roméo et Juliette, la baguette du compositeur aidant à titre très exceptionnel. La voix de�Sapho, (celle d’Eva Dufranne en 1884�) (Cf�: Première représentation de Sapho, le 16 Avril 1851, salle Le Peletier, avec pour interprète principale Pauline Viardot), inspira Gustave Moreau, mais à la lumière de la Grèce ont succédé celles de la Provence et de l’Italie�; "il faut maintenant un repoussoir à la musique satinée et rêveuse de l’ode deSapho", confiait Pauline Viardot à Tourgueniev. Mais il est fort à parier qu’en dépit de la�Mireille�de St Pétersbourg ou de celle du Théâtre Lyrique, Gounod ressentit longtemps et profondément le regret de ne pas avoir été compris par ceux-là mêmes à qui il avait confié ses plus intimes espoirs�: F. Mistral et les Provençaux qui avaient pleuré lorsque Monsieur Pépin (nom inscrit par Gounod sur le registre de l’Hôtel de Ville Verte à St Rémy, où il aurait travaillé à la partition de�Mireille) avait donné son œuvre pour la première fois à St Rémy sur l’harmonium essoufflé de l’Echo des Alpilles.�
Pas plus George Sand � bien que citée à la Note XI du Chant II de�Mirèio�� ** ne devait figurer au�Mortuorum prouvençau�de 1877 qui fait pourtant toujours place aux écrivains de langue française favorables au Félibrige (il est vrai qu’à l’époque de la disparition de George Sand (8 Juin 1876) Frédéric Mistral était tout entier occupé par les préparatifs de son mariage)et contrairement au grand Lamartine qui de Milly à Laeken en passant par Maillane� sut rendre à l’Art Lyrique la place qui lui revient, Gounod ne devait pas non plus, jusqu’à ce jour du moins, voir son nom figurer à côté de Mistral et cela en dépit des efforts de Bonaventure Laurens ou de quelque grand Maillanais dont Mistral lui-même. En 1939, Reynaldo Hahn reconstitue l’opéra d’origine en cinq actes, supprime la valse et le dénouement conventionnel et réintroduit la�Scène de la Crau�avec la cantatrice Jane Rolland. Il convenait alors à René Russier d’écrire�: "Nous souhaitons maintenant qu’une dernière étape du retour à la vraie�Mireille�soit accomplie. Nous attendons de M. Busser dans sa présentation actuelle, l’adaptation littéraire du poème provençal étant confiée à un Charles Maurras ou à un Emile Ripert". A l’occasion du�Cent Cinquantenaire�de Frédéric Mistral, la�Mireille�de Gounod fut crée en provençal, revêtant sa robe de lumière avec la langue même du poète de Maillane, prix Nobel de littérature en 1904, puisque selon Villemain et Lamartine, la France est assez riche pour avoir deux littératures et que tout le Midi se retrouve en cette réflexion de Sauveur Selon�: "Chaque fois que Mireille doit chanter et parler en français, j’ai envie d’aller me cacher".
Mise en scène vocale s’il en fût, l’enregistrement historique de 1980 illustre d’une forme nouvelle la voie royale redécouverte par Maria Callas. Mistral, Gounod� (et Tourgueniev, également sensible à cette mise en scène dite vocale�!) n’attendent plus leur interprète lyrique, cette voix à laquelle pensait Musset, qui produit sur nous une impression analogue à la saveur d’un fruit sauvage�: le public magyaro-roumain l’a d’emblée reconnue en la créatrice du rôle�: Monsegur Vaillant, s’accompagnant elle-même dans la�Scène et l’Air de la Crau�sur le plateau de l’Opéra de Cluj-Napoca (Roumanie), le 15 novembre 1982. Quelques vers du Chant I de la�Mirèio�de Mistral, dits par Claude d’Esplas, Président d’Honneur des Amis de Charles Gounod, servirent de prélude à cette "première internationale" à propos de laquelle nous ne saurions que répéter, reprenant les termes mêmes de Charles Gounod à l’heure de�Sapho�: "Elle fut si bien au courant de la partition, qu’elle l’accompagnait � en entier par cœur sur le piano. C’est peut-être le tour de force musical le plus extraordinaire dont j’ai jamais été le témoin et qui donne la mesure des étonnantes facultés de cette prodigieuse musicienne". Tout le reste est littérature, comme disait Louis Viardot, directeur du Théâtre Italien, à Tourgueniev, amateur de voix dignes de ce nom. Mario de L’Islo Archives :
* Lettre de Claude d’Esplas à Marcel Carrières dóu Felibrige Cher Monsieur, P.S. La "Veuve"�Mouret méritait peut-être un satisfecit�?�! ** Chant II, note XI�Mirèio, Frédéric Mistral |
ADG-Paris © 2005-2024 - Sitemap