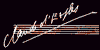|
|
|
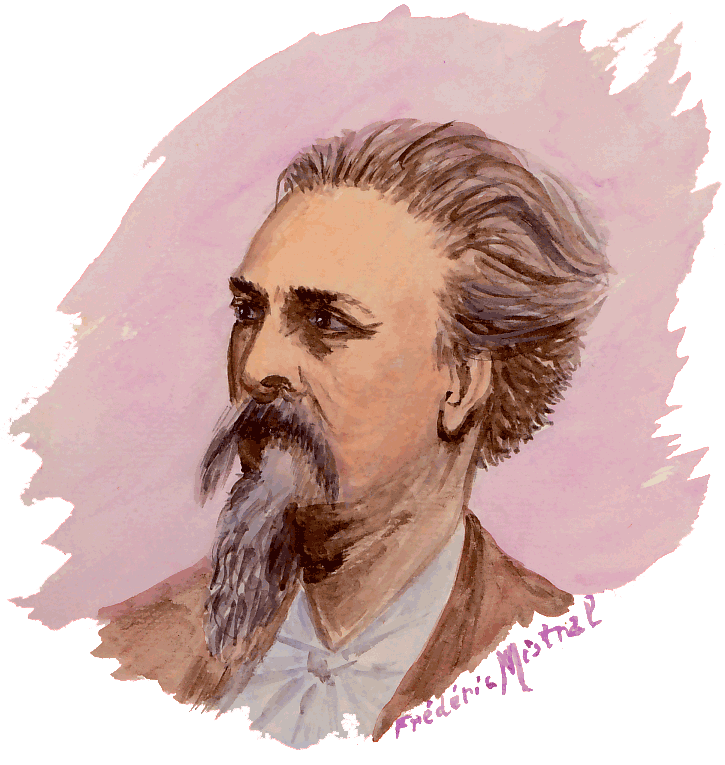 Les Chants du Pays de Foix
A l’abri de leurs montagnes, assez étonnamment, et malgré l’œuvre d’un Gabriel Fauré dont ils constituent toujours la bouillonnante lave, les chants du Comté de Foix (Las cansos del Païs de Fouïch) ont échappé à toute tentative de vraie classification ou de précise restitution musicale, loin de cette Loi du Nord, que Simon de Montfort édicta pourtant de Pamiers (1er décembre 1212) et que ses barons — raison d’Etat obligeant et bénédiction des clercs à l’appui — appliquèrent par le fer et par le feu ; chants transmis et retransmis comme mots de passe de générations à générations dans un peuple connu pour sa dignité et un goût pour la liberté hautement exprimés en quelques brûlants moments de l’Histoire, Gasto Febus ayant très vite redonné aux vaincus de la Croisade albigeoise, l’espoir d’une indépendance nouvelle. Chants anciens, émouvants dans leur mystère car ils ne chantent pas le terroir bien qu’ayant circulé sur les voies du Midi, au son du luth ou du psaltérion ou dans les sillons de l’araire, etChants d’auteur, plus récents d’écriture, qui disent la Terre natale et qui ont pressenti que le Progrès détruisait non seulement les ours et les loups, mais pouvait également entraîner la disparition d’une langue (sinon d’un message) sciemment tue ou tuée : Ou bien, encore, que déduire du décompte de ces “trente jours qui courent du 13 avril au 13 juin de l’an 1210”, ainsi qu’additionnés par ce Professeur de Wallonie, soi-disant expert de la Croisade albigeoise et affecté à la Sorbonne pour y, prétendument, enseigner notre langue materne, opération mathématique à laisser sans voix l’ordinateur du Pr Stephen Hawking (Gonville & Caius, Cambridge) à défaut de n’importe quel jury des Certificats d’études primaires d’antan. Les registres latins de l’inquisiteur Jacques Fournier (né en 1285 à Canté, près Saverdun, Comté de Foix, et qui devint Pape en 1334 en Avignon sous le nom de Benoît XII) restant assez curieusement muets sur la position de l’Eglise officielle vis-à-vis des chants profanes en langue vernaculaire (ô Duvernoy !) parvenus jusqu’à nos jours tels que colportés par les troubadours, jongleurs ou autres Escrivans — dont l’Anonyme, auteur fuxéen de la 2e partie de la Chanson de la Croisade albigeoise — se risquera-t-on, cependant, à suggérer que derrière les paroles et les sons de la plupart de ces textes en langue vulgaire (ô Marrou-Davenson !) des plus anodins à la première écoute (La Jano ; Lé chot ; Aval, aval i’a uno pradèto) ou des plus connus (La Canso dels dalhaires, Lé Bouiè) ou des plus grandioses (Aquéros Mountanhos) se cachent en réalité sous-entendus et secrets qui ne réverbéraient écho que dans l’âme des bouviers ou dans celle des moissonneurs, car seuls les mots et les sons pouvaient s’opposer aux implacables déploiements de férocité animale des hommes de justice spirituelle (“comme on dit dans mon pays, où ne vaut la bénédiction, le bâton prévaudra”, ainsi parlait à Prouille, le 15 août 1217, Dominique, docteur espagnol né dans la vieille Castille, inventeur du rosaire, variante de l’abaque à sourates des Frères musulmans, prédicateur et fondateur de l’ordre des Frères prêcheurs, canonisé en 1234) tout en permettant de faire passer l’essentiel de la résistance désespérée des Purs face aux soudards de civilisations encore dans les crépuscules : mots simples ou sons naïfs, clés pour l’ouverture d’une pensée universelle destinée à construire une organisation sociale sans excessives rigueurs, à l’encontre des ribauderies ou césarismes de l’éternel moment. Comment, en effet, accepter de croire que la seule vérité sur les hérétiques soit celle construite à partir d’aveux extorqués aux condamnés de l’Inqui-sition, “Et il se pourrait que, sans elle, il n’y eût plus d’église catholique du tout aujourd’hui”, se réjouit le “bou n’i a” Jean Dutourd, de l’Académie française (France-Soir, 7-11-1998) reprenant allègrement à son compte les objurgations d’un Lothaire Segni, alias le pape Innocent III, dans son appel à la Chrétienté de 1208 : “Pas de pitié pour ces criminels, pires que les Sarrasins”, Lothaire Segni, ancien étudiant de l’université de Paris à laquelle, précise-t-il, “je dois tout ce que sais et tout ce que je vaux”. Propos sur lesquels renchérissent patriotiquement les historiens Ammann et Constant dans leurHistoire de l’Europe et de la France jusqu’en 1270 : “Louis IX fut un saint sur le trône, mais un saint français”, jugement qui provoquera la verte réplique (sous le chêne ?) d’un Louis-Ferdinand Céline, circulant, lui aussi, d’un château l’autre : “Saint Louis, la vache ! ... pire qu’Adolf le mec ! ... Ah ! Le Saint Louis ... canonisé, 1297 ! ... on en reparlera ! ...”. Ces condamnés de l’Inquisition livrés au supplice par des interrogateurs véhiculés dans les impedimenta (bagages) de Croisés venus du Nord sous les étendards d’une orthodoxie inexorablement transalpine, parfois transpyrénéenne (ô Simon, ô Dominique, ô Aquinas !), orthodoxie s’autosustentant d’incantatoires litanies indéfiniment psalmodiées par une foultitude de déterreurs de tablettes, de dérouleurs de papyrus, de détrousseurs de chartes, docteurs confortablement engoncés dans leurs chaires-cathèdres, ahanant à toussoter (ô Jobelin Bridé !) leur Histoire grégorianisée devant des adorateurs en soif de béatification qui, des Lieux Saints Dominicains à la Montagne Ste Geneviève (n’oublions pas ces Sessions d’histoire religieuse sises au Centre Dominicain de Fanjeaux, Sessions placées sous la haute autorité du Président de Paris-IV Sorbonne !), qui, des collines de Palestine aux platitudes des Flandres (n’ignorons pas l’Université Hébraïque de Jérusalem et son antenne occitanique du 16 rue de la Sorbonne !), qui, des vallonnements de Tübingen aux neiges du Fuji-Yama (n’omettons pas ces sections d’assaut, linguistiquement formées à la langue gasconne par Herr General Ernst Gamillscheg, avant d’être larguées sur la Haute-Ariège et de s’y trouver rapidement capturées pour insuffisance de prononciation locale, puis regroupées devant la gare de Saverdun, près Canté, Pays de Foix !), adorateurs qui se voient eux-mêmes, finalement, intronisés dans les rabelaisiennes “sorbonagreries” patentées de la rue des Ecoles, dans des Collèges à sauce un doigt béarnaise ou en des Centres Nationaux de Recherche Approximative (le fin’amors, kesako ?) ; tout ce mouvant magma inlassablement touillé par de vertigineux romanciers de gare à l’occitane, ou onéreusement “lifté” par de diplo-matiques esthéticiennes en manque de produits de beauté, qui s’acharnent à vouloir redonner au visage ridé du “catharisme”, un faciès des mieux véridiquement gnafronesque, afin de le mieux marionnetter, sans doute, entre les murailles de carton-pâte de châteaux-forts en mal de tertres, ou de le tympaniser dans les flonfloneries déchaînées par le trémulant bâton de quelque meneur de revue de moulin à galette, champion décoré de la note à son plat sans autre réelle portée que celle de gaver les oies du “Grrrrrand Théâtre” (Gabriel Fauré dixit) ou les canards de la halle aux grains et ce, pour le plus grand profit des “ululeurs d’église” (ainsi le Toulousain Pierre Garsias interpellait-il les Franciscains du ... chevalet) sinon d’autres godichonnants manieurs de croches, compositeurs de fortune, déposant leurs statuettes de glaise aux pieds d’une idole de Pierre.
Toutes ces légions de redresseurs de conscience parfaitement incapables, bien sûr, de comprendre, de parler ou de chanter la langue dont ils dissertent, toutes et tous fac-similateurs de la “losange” (dénonciation calomnieuse) soigneusement recélée dans le manuscrit 4030 de la bibliothèque vaticane et telle qu’indulgemment duplicatée dans les officines de Robert de Sorbon, chapelain et confesseur de Louis IX, en des myriades de thèses, antithèses, saintes thèses en attente de “Nihil obstat”, pour la plus grande gloire de Saint-Frusquin ou, plus simplement, de Sainte- Anne (ô Dr Rouquet !) et qui en sont encore, au bout de sept siècles de fol’erranza (quantique soit-elle) ou, si l’on préfère le patois de la Somme, de douchereux errements (cantiques soient-ils), à louer les mérites d’une forme qui, en franc parler wallon, ne vaudrait “rien” ; ce qui justifierait ainsi pleinement, eschatologiquement sinon scatologiquement, la naturelle conclusion de l’auteur anonyme de la Vie de Ste Catherine, en patois picard, pour mieux marquer, à coup sûr et une fois pour toutes, le territoire de l’Occupant :
Ce message initial, donc, initiatique pour certains, nous avons essayé de l’entendre, peut-être de le faire entendre, en cette restitution des chants d’une résistance vocale, toujours événementiellement de mise, même si, en les termes de Gabriel Fauré(élève de Saint-Saëns, lui-même élève de Gounod) : “des chansons populaires ne suffisent pas à créer un art musical national. Elles doivent en former la base, le substratum en quelque sorte. Il faut que des musiciens, de vrais musiciens, connaissant à fond leur métier et pourvus du don créateur, sachent s’en inspirer.” Gabriel Fauré qui, rendons-lui cette justice, resta toujours fidèle au camp de l’hérésie (en juin 1911, il présidait le Comité pour l’érection du Monument à Esclarmonde), Gabriel Fauré, qui, par ailleurs, ne manquait jamais d’assister aux réunions annuelles des Ariégeois de Paris où l’on parlait “patois” (le compositeur ariégeois n’ignorant rien de la langue de ses aïeux) et où l’on chantait à l’unisson le Arièjo, moun Païs, de Sabas Maury, curé de Varilhes, mais aussi le non moins célèbre quatrain montségurien, de toujours vivante actualité :
“Lou soulèu me fai canta” (le soleil me fait chanter) aimait à répéter Frédéric Mistral au peintre-musicien Bonaventure Laurens qui venait de parachever son portrait — il avait également signé celui de Gounod — tout en insistant sur l’importance de la lumière et de la musique au départ de son inspiration lyrique ; le peintre qui, de son côté, déplorait l’absence d’un piano à Maillane, instrument qui aurait permis d’accompagner Roumanille, Aubanel, Seguin et d’autres, sans oublier Charloun Rieu et Frédéric Mistral, bien sûr, lorsqu’ils entonnaient, avec allant, la Chanson de Magali ou d’autres perles du terroir d’Oc. Car Mistral, en personne, y allait de sa voix “chaude et musicale”, plus tard “parfois lointaine, mystérieuse et voilée”, soit pour chanter la Coupo, tel un “grand prêtre officiant devant la foule des fidèles qui reprenaient en chœur les répons”, soit pour répéter le refrain de la chanson gaillarde que Félix Gras avait consacrée au Pape Clément V, soit encore pour détailler les couplets grivois des Maillanais visant les Saint-Roumiérens :
La farandoulo de Trenco-Taio, A la table provençale, Denis Poullinet, l’un de ses proches, rapporte que Frédéric contait mille merveilles mais qu’il aimait imposer ses chansons préférées : Les Célibataires, créée pour la noce de Ranquet, ou la Chanson des Conscrits, petites polissonneries n’entachant en rien les complaintes ou cantiques retenus avec ferveur parce que rapportés par Madame Mistral-mère des pèlerinages de Sant Gènt, des Saintes Maries ou plus simplement de Graveson. Dans un registre non moins émouvant, Mistral, poète patriote de l’Occitanie, allait à ce lyrisme atavique, à ces particularités du Peuple du Grand Sud dont la Chanson de la Croisade albigeoise constituait, disait-il, la “Bible de notre nationalité”, exactement comme il voyait dans les chansons volantes les “feuillets détachés” du Nouveau Testament de cette Bible, feuillets dont il n’hésitait pas à accroître le nombre, aidé en cela par ses amis ès Félibrige, puisqu’il assignait à ses chansons un rôle dans ses doctrines et son combat. Car Mistral n’avait pas oublié, non plus, sa première rencontre au Café dóu Soulèu avec Rosa Bordas, la Mountelenco, chanteuse à qui il consacre un chapitre entier dans ses Memòri e Raconte (Mémoires et récits), la Montelaise qui ne lui créa, pourtant, ni la Coutigo, ni ses autres chansons, ni, bien sûr, Mirèio. Enfin Mirèio vint ... “Mais, Maître, elle ne pourra jamais chanter cela !”, s’exclama Saint-Saëns, effrayé par les moyens vocaux exigés d’une Miolan-Carvalho pour détailler l’air de la Crau dans la version initiale de Mireille ; à quoi Gounod rétorqua : “il faudra bien qu’elle le chante, en ouvrant démesurément des yeux terribles ...”
On sait comment le critique Scudo reprocha au compositeur de Faust, un voyage “inutile” en Provence. Le 23 mars 1863, Gounod s’était discrètement installé sous le nom de Monsieur Pépin à l’hôtel Ville Verte de Saint-Rémy aidé en cela par l’organiste Monsieur Iltis, directeur de l’Orphéon, puisque Mistral à qui il avait demandé la permission de mettre Mireille en musique, l’avait encouragé : “vous êtes venu au monde pour découvrir la Provence ... Vous le tenez votre Opéra !” Gounod fit donc le voyage “inutile” en Provence, tandis que la partition de Mireille rouvrait le débat d’une musique dont la franchise mélodique et les élégances harmoniques qui endimanchaient la petite paysanne naïve du Mas du Juge, loin des emphases lyriques des soubrettes et marquises du XVIIIe siècle ou des héroïnes romantiques qui leur succédèrent, ne pouvait, pas plus, déboucher sur les French cancans à la mode d’Offenbach. Non moins formelle, pourtant, s’était montrée la presse de Marseille, en l’occurrence le Petit Marseillais du 11 juillet 1914 qui titrait : “C’est ce soir, à 8 h 15, que nous assisterons à une grandiose manifestation artistique, au théâtre de plein air d’Athéna-Niké. Pour permettre à Gounod de composer les pages immortelles de Mireille, Michel Carré écrivit son livret d’opéra d’après le poème provençal de Frédéric Mistral. C’est le livret de Michel Carré que viennent de traduire en Provençal, avec un réel bonheur, Messieurs Pascal Cros et Jean Monné. L’interprétation du chef-d’œuvre de Gounod a été confiée à des artistes d’élite, tous Provençaux. Ce sont, l’excellent ténor Martel, qui nous revient du Théâtre de la Monnaie ; l’éminent artiste Marcel Boudouresque qui triompha de nouveau, il y a quelques jours à peine, à l’Opéra-Comique ; l’exquise Maryse Récam, de l’Opéra-Comique, elle aussi, dont l’organe s’est développé de façon étonnante ; le superbe baryton, M. Janaur, qui obtint, à son passage à l’Opéra Khédivial du Caire de nombreux triomphes ; la charmante dugazon de l’Opéra municipal de Marseille, Mademoiselle Michaël, enfin Mesdemoiselles Lise Pierson et Marcelle Nicolas et Messieurs Berton et Rivet. 75 choristes des Concerts Classiques et de l’Athéna-Niké, forment avec l’orchestre de l’Opéra municipal, un cadre imposant, que dirigera habilement Monsieur F. Rey ...” Et le journal d’ajouter : “Les Lecteurs du agiront sagement en s’assurant de leurs places et de leurs tickets de tramways spéciaux, au bureau de location de l’opéra municipal, rue Molière (Tél. 3.58).” Louer sa place, oui, mais dans quelle langue la retenir au téléphone, à lire la publicité du 9 juillet, faite sous forme d’un dialogue en provençal pour le demandeur de Ventabren,en français pour la locationnaire qui finit par dire : “Flûte ! Monsieur, quand on parle une langue étrangère on se fait accompagner au téléphone par un interprète... Je vous salue” ; et le demandeur de conclure : “Aquelo empego ! Parei que sian d’estrangié à Ventabren !” (Cette empoissée, il paraît qu’on est des étrangers à Ventabren !). Et c’était en 1914 ! constate Paul Nougier, directeur du Rampau d’óulivié, qui nous rapporte cette belle histoire (lettre du 17 octobre 1978).
Le 13 juillet 1914, ce même Petit Marseillais triomphait : “Mirèio, l’opéra comique de Gounod, est chanté pour le première fois en langue provençale avec un très vif succès. Non moins formelle, enfin, sera la presse d’Arles du 14 juillet 1914, au lendemain de la représentation de Mirèio, où l’on pouvait lire : “l’orchestre accorde ses instruments pour la représentation de Mirèio, la Mireille de Gounod, dont le livret a été traduit pour la circonstance en provençal. La traduction que Monsieur Pascal Cros, félibre marseillais, a faite du livret, a-t-elle eu pour résultat de donner au moins une apparence provençale à cette œuvre sans caractère provençal ? Je crains bien que non et qu’il faille seulement louer l’intention pieuse du traducteur ... Lorsqu’il fut question de la traduction de Mireille, Madame Mistral déclara très catégoriquement qu’elle n’autoriserait la représentation, en ce qui la concernait, que si la traduction était faite en pure langue rhodanienne. L’engagement fut pris et son observation placée sous le contrôle de Monsieur Jean Monné, Majoral du Félibrige. Que s’est-il passé ? Je l’ignore, mais à l’audition nous avons constaté que les vocables marseillais, le patois marseillais en honneur jadis (la Sartan) pullulaient dans l’oeuvre de Monsieur Cros. La maison n’était pas l’oustau mais la meisoun, ce qui n’a jamais été provençal et ne constitue qu’un exemple entre mille ...” Et Jean du Comtat de regretter : “Et dire que l’on eût pu, pour le dialogue au moins, puiser à pleines mains dans le texte même du poème mistralien ! Fort heureusement la brise dispersa rapidement et escamota, en grande partie, la partie parlée de la pièce et les mélodies de Gounod firent passer le reste sans trop de difficulté” ; tandis que Falco de Baroncelli, lançant, à poignées, des vers à l’immense foule, s’écriait, vengeur : “Vengue li jouino chato !” (A nous, les jeunes filles !). Ne célébrait-on pas en Arles, la Festo Vierginenco ? Tous ces remugles amenant “Parlo Soulet” (le Félibre Louis Gros, d’Avignon) à constater, quelques années plus tard (Le Provençal, 1er février 1950 : A propos de la version en provençal de Jean Monné) qu’il existe du livret de Michel Carré deux adaptations en provençal qui se peuvent chanter parfaitement sur la musique de Gounod. La première est de Raoul de Candolle, la seconde de Jean Monné qui fut Félibre Majoral ... Parlo Soulet qui, dans le même article, souhaitait confier la mise en scène d’uneMirèio en provençal à Marceau Pierboni, Sant-Roumieren d’origine et d’esprit et “régisseur dont nous savons qu’il aime cet ouvrage, le comprend et le peut monter en mettant là, lui aussi, son âme de mistralien ...” Marceau Pierboni (lettre du 26 octobre 1979) nuancera en conséquence : “A ma connaissance, il n’existe aucune trace de la version provençale de Jean Monné. Léon Bancal, ancien Directeur (décédé) du quotidien Le Provençal, petit-fils de Jean Monné, interrogé à se sujet par un de mes amis s’intéressant à la question, avait déclaré à celui-ci, avec regret, n’avoir pu découvrir en dépit de patientes recherches, ce manuscrit dans les nombreux papiers de son grand-père, sa surprise aussi, car il n’est pas douteux qu’il y eut plusieurs copies utilisées obligatoirement à l’époque pour la mise à l’étude de l’ouvrage ... Peut-être savez-vous qu’avant cette version due à Jean Monné (la part de Pascal Cros dans ce travail est pratiquement inexistante), deux autres versions dont on a peu parlé avaient vu le jour. La première fut l’œuvre d’un érudit Saint-Rémois, Adolphe Michel qui avait fréquenté Gounod lors de son séjour à Saint-Rémy, ce poète qui mourut en 1904 avait réalisé son travail sur la version originale de Mireille, qu’il avait transcrite entièrement. La seconde version est du Félibre Ravous de Candolo, mort à Aix en 1915. Il ne reste guère plus de traces de ces deux-là que de celle qui nous occupe (N.d.l.r. : M. Marcel Bonnet, Félibre Majoral, nous avait assuré toutefois, dans sa lettre du 20 janvier 1978, qu’il était en possession du manuscrit de la traduction du libretto de Mireille, en provençal, faite par Adolphe Michel, manuscrit qui lui a été remis par la petite-fille d’Adolphe Michel).
Peut-être pourrait-on essayer de trouver une explication à cette carence. Il est curieux, d’une part, que la veuve de Frédéric Mistral dont on connaît la farouche intransigeance, ait permis non seulement l’adaptation mais aussi la représentation d’uneMireille autre que celle acceptée par le Maître. D’autre part, il serait surprenant que Michel Carré, auteur du libretto et, surtout, l’éditeur Paul Choudens n’aient pas eu leur mot à dire en cette circonstance. Il est possible que dans l’esprit de l’une comme des autres, la représentation (peut-être d’essai) à Marseille et celle “rituelle”, dirons-nous, d’Arles, ne devaient pas avoir de lendemain ...” La presse de 1864 n’en parla pas moins de “berquinade”, de musique “délayée et décolorée”, de “Sur le Pont d’Avignon, on y crève, on y crève...”. S’étonnera-t-on, alors que Mistral qui avait autorisé l’œuvre (il avait pleuré à Maillane — on se le rappelle — lorsque Gounod lui avait lu le libretto français de Michel Carré) se plaigne à son tour : “on m’a abîmé, écorché, défiguré, etc.”, admettant toutefois que cela lui avait valu de “jolis droits d’auteur.” Quant aux Félibres (les mainteneurs de la langue provençale, admirée de Lamartine et qui valut à Mistral un prix Nobel de Littérature, en 1904) ils firent la moue : “Empachan pas d’amira la Mireille de Gounod, chacun soun goust.” (Nous n’empêchons pas d’admirer la Mireille de Gounod, à chacun son goût), Bonaventure Laurens ayant déjà, de son côté, prévenu Mistral : “Nous, Provençaux, nous voudrions même, qu’avant tout, les personnages (de l’opéra) parlassent la langue de votre poème et non pas le Français.” Et chacun de choisir son camp, des Cours d’Aix-en-Provence jusques aux fins fonds de l’Europe, aux limites mêmes de cet Empèri dóu Soulèu (Empire du Soleil) le grand rêve du Poète de Maillane, la Roumanie en l’occurrence, puisque Vasile Alessandri, le poète roumain, s’était vu décerner le Grand Prix aux Jeux Floraux du Félibrige (Montpellier, 25 mai 1878) tandis que vingt et un députés roumains signaient un télégramme invitant leurs “frères latins” à se rendre à Bucarest. Ronsard n’avait-il pas, lui-même, obtenu aux Jeux Floraux de Toulouse, en 1580, la statuette d’argent pour une pièce dans laquelle il chantait son aïeul Banul Mârâcinâ, accouru des bords du Danube pour porter secours à “France, mère des arts, des armes et des lois”, inaugurant ainsi une continuité historique (Nerto, de Mistral, est dédiée à sa gracieuse Majesté la Reine Elisabeth de Roumanie, maîtresse ès Jeux Floraux) non désavouée par l’Université (le Professeur Boutière était, nous l’avons vu, Directeur de l’Institut d’Etudes provençales et roumaines de la Sorbonne) ou par l’Art lyrique, puisque Mirèio devait trouver consécration sur le plateau de l’Opéra d’Etat Roumain (voir l’Histoire du Félibrige du Capoulié René Jouveau, ouvrage couronné par l’Académie française) lors du Concert Exceptionnel de la cantatrice-pianiste concertiste Monsegur Vaillant rendant à Mirèio, dans le pur parler rhodanien, cet habit de lumière dont elle avait paré, quelques jours plus tôt, la “Violetta” de Verdi (Opéra d’Etat Magyar) tout comme, ou presque, la Traviata de Verdi avait remplacé à l’affiche du Théâtre Lyrique, à Paris, le 27 octobre 1864, la Mireille de Gounod. Laisserons-nous Frédéric Mistral, scander l’accord final :
“Mirèio, un bèu matin, cantavo
CLAUDE D’ESPLAS
|
|
ADG-Paris © 2005-2024 - Sitemap